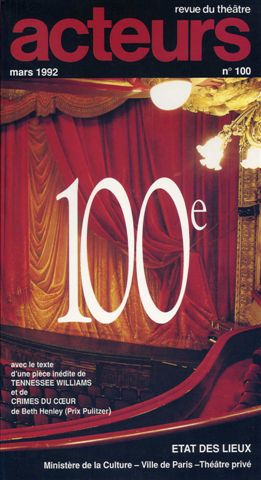Pierre Laville durant les répétitions d'Occupe-toi d'Amélie (septembre 2012)
Écrits sur le Théâtre - fragments
> ÉDITORIAL : DES OBJECTIFS (Acteurs n°1 - janvier 1982)
> ÉDITORIAL : IL FAUT QU'UN THÉÂTRE SOIT PUBLIC OU PRIVÉ (Acteurs n°2 - février 1982)
> PORTRAIT D'ACTEUR : CATHERINE HIEGEL, BOVARIENNE (Acteurs n°3 - mars 1982)
> PORTRAIT D'ACTEUR : CHRISTINE FERSEN, ÉMIGRÉE (Acteurs n°3 - mars 1982)
> PORTRAIT D'ACTEUR : ANNIE DUCAUX, JEAN-PAUL ROUSSILLON, SOCIÉTAIRES HONORAIRES (Acteurs n°7 - juillet 1982)
> HOMMAGE : EN 1973, ÂGÉ SEULEMENT DE 58 ANS, JEAN-MARIE SERREAU NOUS QUITTAIT (Acteurs n°13 - mai 1983)
> ÉDITORIAL : L'AUTEUR - LE NOUVEL ÂGE (Acteurs n°13 - mai 1983)
> ANNIVERSAIRE : IL Y A VINGT ANS : « CRIPURE » (Acteurs n°12 - mai 1987)
> ÉDITORIAL : MARGE ÉTROITE - Malaise du Théâtre (Acteurs - mai 1995)
> ÉDITORIAL : L'IMAGINATION N'A PAS DE FORME...(Acteurs n°93 - 1995)
> UNE DRAMATURGIE DU PASSAGE
> PARLER N'EST PAS JOUER (Mars 1985)
> ÉDITORIAL : « L'IMAGINATION N'A PAS DE FORME » (Peter Brook) (Théâtres - Septembre 1985)
> ÉDITORIAL : TRANSLATION (Théâtres - Janvier 1986)
> ÉDITORIAL : « C'EST EN ÉCRIVANT QU'ON DEVIENT ÉCRIVERON » (Raymond Queneau) (Théâtres - juillet 1986)
> ÉDITORIAL : DISPARITIONS (Théâtres - novembre 1990)
> ÉDITORIAL : TRAQUER L'EXCELLENCE - Vingt ans au Soleil (Théâtres - janvier 1991)
> ÉDITORIAL : UNE ANNÉE DE THÉÂTRE (Théâtres 1991-1992)
> ÉDITORIAL : À PROPOS D'UNE ANNÉE DE THÉÂTRE - Signes et réalités (L'Année du Théâtre - 1992-1993)
> PORTRAIT D'ACTEUR : MARCIAL DI FONZO BO (L'Année du Théâtre - 1994-1995)
> ÉDITORIAL : LA FORÊT DE VARIANTES MULTIPLES (Théâtres - mars 2002)
> ÉDITORIAL : DU CHANGEMENT (Théâtres - mars 2002)
> HOMMAGE : RAYMOND GÉRÔME (Théâtres n°2 avril 2002)
> HOMMAGE : JACQUES MAUCLAIR (Théâtres n°2 avril 2002)
> LARS SCHMIDT : LETTRE À UN AMI...
> PIERRE LAVILLE : SAM SHEPARD ETAIT UN FAUX COW-BOY A L'ELEGANCE NONCHALANTE
> EDWARD ALBEE, LA NOSTALGIE DE L'ENFANT

ÉDITORIAL : DES OBJECTIFS
(Acteurs n°1 - janvier 1982)Pour définir notre projet de créer une revue de théâtre, on pourrait dire : « II s'agit de Théâtre. Il s'agit du Théâtre, du recueil de ses gestes, de ses annales, il s'agit de sa continuité et de son entretien. »
Acteurs, revue mensuelle, paraissant le quinze de chaque mois, à raison de dix numéros par an, est vouée au théâtre, au théâtre seulement, à l'exclusion de toute autre expression artistique.
Acteurs est ainsi nommée par reconnaissance intense de l'Acteur, qui permet et accomplit l'acte théâtral même à l'instant précis où cet acte se crée. Hommage donc à l'Acteur. Si toute pratique du théâtre et les questions qu'elle soulève impliquent, « traversent » la fonction de l'acteur (à preuve, par exemple, tout ce que la notion de troupe agite) nous n'oublierons pas tous les autres artisans/artistes qui travaillent au théâtre et tout particulièrement, cela va de soi, l'auteur et le metteur en scène.
Nous proposons une revue de la pratique du théâtre sous toute ses formes. L'art théâtral ne connaît une réussite complète que lorsque s'épanouit l'harmonie des fonctions et des « rôles » de ceux qui le créent.
Acteurs sera une revue d'information, d'incitation et de réflexion. Elle ne sera pas un support critique, de jugement, d'évaluation. Il n'existe pas à ce jour de revue de ce genre, alors que les revues d'information abondent pour ce qui est du cinéma, de la musique, du lyrique, de la danse. Ce défaut d'information est une des raisons des difficultés d'accès sinon du défaut d'entraînement du public qui a besoin d'être informé, de connaître, d'être préparé à faire ses choix et ouvert au désir d'éprouver le plaisir du théâtre. Nous avons l'ambition de l'y aider.
Acteurs est une revue indépendante. Nous ne voulons pas nous limiter à un espace esthétique ou politique étroit. Ce qui ne signifie nullement que nous ne dirons pas notre fait, ni que nous ne prendrons pas position. Au contraire nous ferons des choix (positifs) qui formeront une ligne globale.
Elle est une revue ouverte. En un temps où chaque créateur valorise lui-même à l'excès son propre travail et se théorise lui-même, où l'on voit surgir des procureurs, où, surtout, le public est atomisé et les formes de spectacles très diverses, nous tenons à rendre compte de ces variétés, en écoutant, en essayant de comprendre chacun, et en dégageant, s'il y a lieu, des relations.
Acteurs est en priorité destinée au public, aux spectateurs. En second, à l'ensemble des nombreux professionnels ou amateurs qui ne connaissent pas toujours la pratique du théâtre (combien de manques découvre-t-on chez des comédiens ou des auteurs, par exemple).
La décision de créer Acteurs a été prise avant le printemps de cette année 81, où l'on sait ce qui s'est passé. Soyons clairs : il n'y a pas de lien ni de rapport délibéré avec le changement de politique culturelle. Reste qu'il y a, sans doute, effet indirect, ne serait-ce que par l'incitation provoquée par la disparition de ce qui, au cours des années précédentes, contenait d'indifférence, de découragement, accentuant les contradictions, usant les initiatives.
Acteurs ne dépend pas davantage de l'action de tel ou tel animateur ou de telle ou telle entreprise.
Une équipe de rédaction permanente se dégagera parmi ceux qui prêteront leurs concours : critiques, hommes et femmes de théâtre, écrivains... Chaque numéro comprendra des chapitres réguliers. Outre les articles d'informations et une « mémoire » par fiches de l'ensemble des créations, nous présenterons les spectacles événements constituant à nos yeux les réussites les plus abouties, et deux sous-ensembles, l'un intitulé « dossier » - traitant d'un thème, d'un homme de théâtre ou d'un sujet d'histoire réactivé par l'actualité - et l'autre « tribune », lieu d'inventaires, de débats.
Acteurs sera, nous l'espérons, nous le préparons déjà, un support à des rencontres et des discussions faisant lien direct entre les gens de théâtre et le public, et aussi d'approfondissements (édition d'ouvrages en forme de numéros spéciaux, en coproduction).
Nous venons de vivre, au théâtre, les désordres, les formes d'éclatement, les mises en doute, les fractionnements du public, les intimidations intellectuelles, et les expérimentations les plus vivantes et passionnantes, ou démobilisantes selon les cas. Cela n'en a pas fini de finir. Nous vivons aussi un temps où toute équipe théâtrale naissante exige un droit à l'aide publique, et où l'exploitation traditionnelle de l'entreprise théâtrale s'épuise. Des temps nouveaux ? Disons, très simplement, ce qui est déjà lourd, que nous serons particulièrement attentifs à toutes les imaginations nouvelles. Acteurs prétend répondre à la nécessité d'en rendre compte.
ÉDITORIAL : IL FAUT QU'UN THÉÂTRE SOIT PUBLIC OU PRIVÉ
(Acteurs n°2 - novembre 1985)Les déclarations récentes et l'évolution des carrières de Jérôme Savary et de Gildas Bourdet, la longue absence de Planchon vont dans le sens d'un désengagement du secteur public, et marquent une étape.
Quant à l'État, il intervient de plus en plus dans le secteur privé (Athénée, théâtre de Paris, ou par le biais de coproductions). Tout va comme si les deux secteurs public et privé, de longue date antagonistes, se rapprochaient, se réunissaient — ce dont on ne peut que se féliciter, ce que nous plaidons ici depuis le premier jour. Cependant cette situation exprime un malaise.
Pour ce qui est du secteur public, les différents types d'entreprises ne se portent pas bien, en dépit d'une irrigation financière large assurée par le gouvernement actuel. Cet argent frais a nourri les institutions en tant que telles et adouci les pressions syndicales, mais n'a que fort peu (et fort inégalement) servi à amplifier la création et à gagner un public. Or ces institutions sont lourdes, grippées, et semblent vieillies. Comme s'il y avait divorce entre ce qu'elles sont et qui est budgétivore d'une part, et le désarroi sinon l'échec de la mission qui est la leur.
Les théâtres nationaux ne sont plus des exemples et des référents de premier rang — or ils le doivent, l'importance de leur budget, leur titre et leur cahier des charges l'exigent. En Décentralisation, mises à part deux ou trois entreprises (TNS, TNM, Caen), on ne se décentralise que du bout des lèvres, on ne vise que Paris, on cherche les « coups » mondains, on néglige radicalement les interventions locales, modestes, en profondeur (ô Dasté, ô Gignoux !), on se résigne à un publiC vacillant. Quant aux Compagnies, elles sont à l'affût de tous les feux et de tous les lieux, avec, trop souvent, arrogance : n'importe qui pouvant se prévaloir (prématurément) d'une subvention — c'est-à-dire d'une reconnaissance par l'État français de l'utilité publique de leur travail d'artiste (?) — pérore, exige. Le foisonnement qui en résulte n'est pas sain.Malaise du théâtre privé également. Dieu merci, l'Association pour le soutien au théâtre privé que fonda Jacques Duhamel sur les instances d'Antoine de Clermont-Tonnerre — rendons à César... — est devenue l'instrument le plus souple possible et le mieux ajusté. Elle corrige autant que se peut les déboires éventuels d'entreprises en constant état de risque. Certes, un certain nombre de salles privées connaissent encore un type de gestion archaïque, mais la production dans son ensemble a évolué et le secteur est devenu plus compétitif. Il le faut car les obstacles sont fréquents, qui vont d'une crise de public pour raison d'événements d'actualité... au beau temps (celui de septembre/octobre a vidé les salles), à la raréfaction du répertoire (les auteurs préfèrent film à succès ou les facilités du café-théâtre). Et aussi l'accueil de spectacles préamortis venus du secteur public, qui est une facilité de trésorerie, un pis-aller, et coûte parfois plus qu'il ne rapporte.
Que faire ? Côté secteur public, repenser les institutions» revoir les missions, imposer radicalement un cahier des charges, autrement dit décentraliser au sens propre, et moraliser — n'ayons pas peur des mots.
Côté privé, s'unir pour mieux comprendre l'effort accompli par les théâtres privés, leur souhaiter un soutien plus net et argenté, alléger leurs charges et leur fiscalité. Pour notre part, Acteurs y contribuera et fera tout pour mieux informer des enjeux et des pratiques. Dorénavant nous publierons dans chaque numéro un reportage sur chacun des théâtres privés et un entretien avec chaque directeur (trop modeste, souvent mal connu). Suivront des dossiers, et avec Auteurs, une fois sur deux, les textes de nouvelles pièces.
PORTRAIT D'ACTEUR : CATHERINE HIEGEL, BOVARIENNE
(Acteurs n°3 - mars 1982)À sa sortie du Conservatoire, on qualifiait Catherine Hiégel de « comique » — entendez, au sens noble, « soubrette », ou, moins honorable, « p'tite femme » de Boulevard (où elle a débuté en effet dans » et Boeing, Boeing) : une taille assez petite et ronde un nez en l'air, l'œil qui tortille, une voix solide pour le vaudeville. Au Français, d'ailleurs, où elle entre aussitôt, c'est bien cela qu'elle joue, du genre Marinette, Zerbinette, Toinette... avant de glisser vers Marivaux (Lisette and C°).
Puis vient la rupture, avec Angélique de George Dandin, âme en silex, une aventure noire des mal-mariées conçue par Jean-Paul Roussillon. On s'est dit tout à coup : voilà une actrice nouvelle ; nouvelle voulant dire qui peut apportes une nouveauté de jeu. des émotions singulières lui appartenant seulement, hors des codes connus (Roussillon fut Pygmalion). Non pas que son interprétation fût évidente et qu'elle s'imposât, non. ç'en était même loin, dans un entre deux ; mais ce qui se passait valait mieux, je le répète, cela engageait un autre avenir. Dans la foulée. il y eut La navette de Becque. et Mademoiselle Molière de L'impromptu de Versailles : des bourgeoises coquettes et, comme on disait, cruelles, à ruiner et désespérer des amants fades, ou des battus et contents.
Disons au passage l'intéressant sort réservé depuis pas mal de temps aux soubrettes de notre époque : le temps des Kolb. Dussane, Bretty est fini — soubrette l'on naissait, soubrette l'on était retraitée (toute une vie s'écoulait à glisser de la jeune Zerbinette à la mature Dorirne). Désormais, Micheline Boudet. Catherine Samie. Catherine Hiégel (bientôt Christine Murillo) en moins de dix ans bousculent les « emplois » et galopent de Molière ou Marivaux ou Beaumarchais à Tchekhov, Shakespeare, Euripide ou Strindberg. Cela fait des carrières riches et animées et des épanouissements personnels rares. On ne « sert » plus impunément.
Donc, Catherine Hiégel fut soubrette et vaudevillisa. Du temps de Robert Kemp. on aurait vanté sa « vis comica » et son regard « qui frise ». Le passage, ce fut aussi une mise en scène - remarquable « Misanthrope » qu'elle signa avec Jean-Luc Boutté il y a six ou sept ans. et que je vis sous un chapiteau hasardeux dans une banlieue anachronique. En vérité, Catherine Hiégel est une grande actrice moderne, un grand premier rôle fait pour se risquer dans les sous-textes, dans les non-dits dangereux, dans les subtilités soudain déchirées par des cris et des terreurs. Bien sûr. elle peut être encore l'intelligente et charnelle Locandiera (elle en joue l'en-dessous plus que l'image), mais Catherine Hiégel c'est d'abord une Titch, Natacha des Trois sœurs, et surtout, surtout, la bergmanienne, la bovarienne Tekla de Créanciers. Là, dans Strindberg, en gros plan sur le petit bout de Petit Odéon, l'intuition tragique, la dureté sans pitié inutile, la limpidité d'une tendresse sans espoir, la haute tenue morale de l'actrice l'ont faite grande, belle, pure. Superbe.
Principaux rôles en 1982:
Marinette (Le dépit amoureux, Molière Lisette (Le jeu de l'amour et au hasard, L'épreuve, Marivaux), Manon (Les fausses confidences, Marivaux). Toinette et Angélique (Le malade imaginaire, Molière), Mathurine (Don Juan, Molière). Angélique ( George Dandin, Molière), Henriette (Les femmes savantes, Molière). Mariane (L'avare, Molière), Agathe ( Électre, Giraudoux), Clara (Le dindon, Feydeau), Mlle du Croisy (L'impromptu de Versailles, Molière), Cathos (Les prérieuses ridicules, Molière), Elle (Cœur à deux, Foissy), Cléanthis (L'ile des esclaves, Marivaux), Frida (Henri IV, Pirandello), Emilie (Cinna, P, Corneille), Hyacinte (Les fourberies de Scapin, Molière), Mlle Molière (L impromptu de Versailles, Molière), Antonia (La navette, Becque), Lisette (Les acteurs de bonne foi, Marivaux), Colombine (Les Italiens à Paris, Charras et Gille), Magda (Le ouallou, Audiberti), La fille d'Antiochus (Periclès, Shakespeare), Une Ondine, Grete (Ondine, Giraudoux), Titchie (Chez les Titch, Calaferte), La femme du pasteur (Maître Puntiia et son valet Matti, Brecht), Juliette (Le roi se meurt, Ionesco), Le chœur (Œdipe, Gide) , Brigida (La villégiature, Goldoni), Natacha (Les trois sœurs, Tchekhov), Mareda Ruiz (La tour de Babel, Arrabal), Tekla (Créanciers, Strindberg), Irma (La folle de Chaillot , Giraudoux), Mirandoline (La locandiera, Goldoni).
PORTRAIT D'ACTEUR : CHRISTINE FERSEN, ÉMIGRÉE
(Acteurs n°3 - mars 1982)Un concours du Conservatoire qui a fait date comme pour Hirsch et Duchaussoy, et la Comédie-Française, à vingt ans. Aussitôt les grandes statues tragiques, les cariatides, les froides, les tragiques, les princesses qui ont des malheurs, dont les conflits exaspèrent le destin (sinon les spectateurs) : Chimène. Livie, Emilie. L'infante (de Montherlant). Sabine. Sygne de Coûfontaine, Marianne des Caprices... Le pire emploi au Français, car la tragédie on ne la joue plus guère, ou mal (en attendant Vitez...) ; les comédiens qui lui sont voués sont contraints à protester, car ils ne jouent pas assez et leur état est éprouvant, ce qui ne leur simplifie pas les choses dans la Maison (faites donc parler Fersen de ses rapports avec Dux !). sauf s'ils se résignent et en quelques années, hop. sur la touche.
Donc, malgré un départ retentissant, Christine Fersen, cataloguée reine, a piétiné. Longtemps. Dix ans, en gros. Jouant ce qu'on appelle des grands rôles. mais peu. pas longtemps: d'une passion. comment dire. mentale. Ça grippait. Personnellement, je l'ai connue off Français avec cette Sygne qu'aimait tant Serreau (cela se passait rue de Richelieu. mais ça n'en avait pas l'air) puis à Nanterre où elle fut avec Jean-Pierre Bisson une sorte de Mademoiselle Julie, avec Maréchal pour Fracasse et Béline - remarquable - du Malade, et enfin dans La Célestine, où elle tenait commerce de trottoir somptueusement.
Donc peu à peu, j'ai su qui elle était, d'où elle venait : car Queen Fersen revient de loin. d'un milieu, d'une enfance pauvres, et j'aime ça. l'audace, le courage, la résistance. Et puis. dans la vie de tous les jours, au delà des grands gestes, des grands mots, des cernes d'angoisse, des véhémences, on lui découvre une personnalité flambante, honnête, fidèlement égale à elle-même. tendre, et produisant un vaste rire chaud débordant.
J'ai su, oui, qu'on ne connaissait pas l'actrice. Le meilleur de sa carrière reste à faire. Qu'on lui donne à jouer des êtres plus vrais, plus humains. Moins de reines. des marquises : elle serait une des plus grandes interprêtes de Marivaux qui soient quelle Silvia. quelle Hortense on a manqué : restent Araminte. et bien d'autres).
Et puis. c'est une actrice moderne d'une évidence considérable : amorcée avec Billetdoux. elle fut dans La révolte pour ceux qui ne soupçonnaient pas l'actrice contemporaine (émigrée de l'intérieur au sein du Français) une révélation, imposant une image de femme dense pleine, authentique, aux angles doux dans la détermination absolue, digne d'une actrice étrangère, Cortese, Meryl Streep. Melato, Schygulla.
Marie Tudor est venue. Alors là, ça a marché à bloc, car on la libérait de ses freins, poussant loin ses rires rugis, ses bras flottants, sa démarche taurine tête en avant, possédée par le vertige quasi-mortel, dixit Cervantes, de « l'éclat de rire».
Principaux rôles en 1982:
Chim7ne (Le Cid. P. Corneille), Livie et Emilie (Cinna. P. Corneille). Elsbeth (Fantasio, Musset). Lucrèce (Le menteur. P. Corneille). L'Infante de Navarre (La reine morte. H. de Montherlant). Sygne de Coufontaine (L'otage. P. Claudel). Sœur Catherine de Sainte Flavie (Port-Royal. H. de Montherlant). Sabine (Horace, P. Corneille). Marianne (Les caprices de Marianne, Musset). La belle-tille (Six personnages en quête d'auteur, Pirandello). Elisabeth (La révolte, Villiers de l'isle Adam). Hippolyte (Le songe d'une nuit d'été. Shakespeare). Rosa Lavecchia (Un imbécile.
Pirandello), Benedetta de Narni (Malatesta. H. de Montherlant), Corilla (Corilla, Nerval), Anatolie (Femmes parallèles, F. Billetdoux). La femme (Descente sur Recife, G. Cousin), Lina (Le songe, Strindberg), Augustias (La maison de Bernarda, Garcia Lorca), Areusa (La Célestine, P. Laville d'après Rojas), Laina (Maître Puntila et son valet Matti, Brecht). La reine Marguerite (Le roi se meurt. Ionesco). Le chœur (Meurtre dans la cathédrale, Eliot). Madame Jordan (Edith Détresse, Bauer). Médée (Médée. Euripide).
PORTRAIT D'ACTEUR : ANNIE DUCAUX, JEAN-PAUL ROUSSILLON, SOCIÉTAIRES HONORAIRES
(Acteurs n°7 - juillet 1982)(*) Un sociétaire honoraire, à la Comédie-Française, est un sociétaire mis à la retraite après au moins vingt ans de présence, à qui l'on permet de jouer encore, au cachet, eu égard aux services rendus dans la Maison. Titre honorifique et permission de jeu, pour quelque temps encore.
Annie Ducaux, doyenne
Annie Ducaux débuta, après le Conservatoire, à l'Odéon il y a plus d'un demi-siècle, en des années où l'impact de Gémier était encore sensible. Elle y joua les jeunes premières dramatiques et tragiques, auxquelles la prédisposaient une belle taille, une distinction et une réserve altière, une voix souple dans le grave, avec des brisures aiguës, le sens du drame gestuel et des spriritualités ou des amours blessées. Elle culmina dans cet emploi en créant les œuvres d'un auteur célèbre avant-guerre et étonnamment oublié depuis, Paul Raynal (Tombeau sous l'Arc de Triomphe, Au soleil de l'instinct, Napoléon Unique). Cette image d'Annie Ducaux, on la retrouve dans des films lyriquement désuets (Un grand amour de Beethoven d'Abel Gance). Elle eut aussi, pendant l'Occupation, une phase Bourdet (Hyménée, La prisonnière).
C'est à la Comédie-Française, où on l'engage pour succéder à une illustre démissionnaire, Marie Bell, en 1946, qu'Annie Ducaux va s'épanouir et imposer sa personnalité au premier plan trente-cinq années durant. Entrer assez tard (à trente-huit ans) au Français est souvent un handicap - d'autant qu'on eut l'idée saugrenue de lui faire jouer presque aussitôt Célimène. Mise en scène par Gaston Baty, elle va trouver sa voie. Nommée sociétaire en 1948, elle donnera un grand éclat aux reines et princesses des tragédies classiques, à commencer par Andromaque. En tandem avec Renée Faure (dans la lignée des violentes, des exigeantes, des diamants purs) Annie Ducaux joue les tendres, les victimes lucides, les élégiaques (apparemment du moins) : Bérénice, Monime - ses deux plus grands rôles. Elle joue aussi Marivaux, Hugo et Montherlant (admirable dans Port Royal), avant de s'essayer sur le tard soit aux compositions (La soif et la faim de Ionesco, La folle de Chaillot) et aux reines « méchantes » (Athalie, Phèdre) à qui elle ajoutait, plus ou moins opportunément, son élégance et sa musicalité. Mais il lui suffisait de quelques vers chargés d'émotion - ainsi il y a un an un poème de Péguy — pour atteindre à un art radicalement parfait. Sociétaire honoraire, elle continuera à jouer, nous le souhaitons. Car, disons-le, la Doyenne avait rang et prestige actuellement sans égal dans la troupe des Comédiens-Français. Annie Ducaux est commandeur de la Légion d'Honneur.
Rôles principaux en 1982:
Racine : Bérénice, Monime (Mithridate) Andromaque, Athalie, Agrippine (Britannicus), Atalide (Bajazet) et Phèdre - Molière : Célimène (Le misanthrope / déjà joué à l'Odéon en 1930), Elmire (Tartuffe, avec Ledoux), Aristione (Les amants magnifiques), Philaminte (Les femmes savantes) -Corneille : Arsinoé (Nicomède), Pauline (Polyeucte) -Shakespeare ; (à l'Odéon; Cordélia, La tempête; aux Champs-Elysées : Rosalinde, Comme il vous plaira), Paulina (Un conte d'hiver), Voluminie (Coriolan) -Musset : Mme de Léry (Un caprice), La muse (Les nuits), Marie Solderini (Lorenzaccio) - Marivaux :
Araminte (Les fausses confidences) - Hugo : Duchesse d'Albuquerque (Ruy-Blas) - Et : Clytemnestre (Électre, Giraudoux Une fille pour du vent, Obey), Mère Marie (Dialogue des carmélites, Bernanos), Sapho (Daudet), Duchesse de Malborough (Le verre d'eau, Scribe). Elisabeth (Elisabeth la femme sans homme, A. Josset); Sœur Angélique (Port-Royal, H. de Montherlant), Catherine (La grande Catherine, G.-B. Shaw), Elisabeth (Marie Stuart, Schiller), Tante Adélaïde (La soif et la faim. E. Ionesco). Jeanne (Comme les chardons, A. Salacrou). Pénélope (Le jour du retour, A. Obey). Bernarda (La maison de Bernarda, Garcia Lorca). Femme 1 (Dialogues avec Leuco, Pavese). Jocaste (Œdipe, Gide). Mary Shelley (Le jour ou Mary Shelley rencontra Charlotte Bronté, E. Manet), Aurèlie la folle de Chaillot (La folle de Chaillot, Giraudoux), Isabelle (Le sexe faible, 'Bourdet).Jean-Paul Roussillon, sociétaire à part entière
Pourquoi Jean-Paul Roussillon démissionne-t-il (demander, volontairement, sa mise à la retraite est un acte de départ) de la Comédie-Française ? Sociétaire à part entière, metteur en scène, (la plupart du temps) membre du comité d'administration, en pleine réussite dans son métier d'acteur, metteur en scène indispensable à la Maison — au Français depuis plus de trente ans (engagé le 1er septembre 1950) (1), seulement âgé de quarante-neuf ans : pourquoi ? Pourquoi, alors qu'une seconde carrière ailleurs (à moins de fonder sa propre troupe, voir les Renaud-Barrault) ne se recommence pas — voir les échecs si injustes, si cruels de Renée Faure, Louise Conte, Lise Delamare, Falcon, sans même parler de Camoin ou Arnaud, de Manuel, de Bertheau, de Meyer, la liste est longue, et même Robert Hirsch... (Jean Piat, Micheline Boudet ont réussi un rétablissement, au boulevard seulement. mais l'on ne voit pas Roussillon dans des choses légères, ni même dans Guitry).
Interrogé, il nous a répondu : « J'ai expressément demandé dans une lettre au Comité ma mise à la retraite. Je ne pars pas de la Maison, dans la mesure où je deviens sociétaire honoraire. Mais maintenant, avec le temps, je ne veux plus être sociétaire à part entière ; je n'ai strictement rien contre la Maison, et si la Maison me demande de jouer, je suis à la disposition des Comédiens-Français: Si je pars, ce, n'est pas pour essayer de faire une carrière ailleurs. Je veux m'enlever cette charge que j'ai assumée pendant plus de trente ans, et je suis reconnaissant à ceux qui me l'ont confiée.
Être sociétaire à part entière, pour moi, consiste à faire absolument ce que- l'on me demande... J'ai envie de vivre un peu et de m'établir un plan de travail où je puisse de temps en temps prendre dix ou quinze jours de pause ».Pour qui le connaît, l'exigence de Jean-Paul Roussillon, en effet, n'est pas mince ; elle le possède en entier, elle l'a même dévoré, il s'y perd. Il part, pourrait-on dire, pour ne plus continuer un travail harassant, une discipline intransigeante, sans pause, répondant à on ne sait quel défi venu de l'enfance (il m'a dit un jour : « je n'ai jamais été engagé dans la Maison, j'y suis né ; enfant, mes jeux se passaient dans les couloirs et les ateliers » - son père, en effet, passa sa vie au Français comme technicien et directeur de la scène) genre « rose bud »...
Continuer à y jouer ? Il le dit, on veut le croire ; ce ne sera pas facile tous les jours, mais il aura sans doute envie d'y retrouver ses camarades, et son épouse Catherine Ferran, sociétaire. Mettre en scène, oui, on a besoin de lui, d'un directeur d'acteurs qui obtient de chacun des sortes de nouveautés intimes, et qui « relit » le plus intelligemment Molière et Marivaux.
Je rends hommage à l'acteur (qui a patienté longtemps — dix ans avant d'être nommé sociétaire — dans les « emplois » de Robert Hirsch). Jean-Paul Roussillon, dans son jeu, est capable des plus douées tendresses et des violences les plus inquiétantes, des gestes les plus rationnels et les plus fous, dans le drame (Pirandello) ou le vaudeville (Labiche, Feydeau) (2). Il a été un Valet de grande classe, digne héritier de son maître André Brunot, en Arlequin, Scapin, Pasquin, Pierrot, Dandin, Trivelin ou Sempronio. Il est peu à peu devenu un grand premier rôle - souvenons-nous de son admirable humanité dans La soif et la faim de Ionesco. Chez Roussillon, classique ou moderne, la tradition, chaque fois, est neuve. Un vœu, personnel : il part, il fait une pause, il a besoin (mais ça, il ne le dira pas) de changement ; alors, qu'il fonde une troupe, une compagnie, qu'il se plante dans un lieu, à Paris ou ailleurs. Le théâtre avait déjà besoin de lui, comme il était ; alors, imaginez, d'un Roussillon rasé de frais, retapé, revitaminé !
(1) Stagiaire, pendant le Conservatoire, à quinze ans, dès 1947.
(2) Il avait annoncé qu'il jouerait en alternance avec Yves Gasc, Petypon de La dame de chez Maxim, ce qu'il n'a pas encore fait à ce jour.
HOMMAGE : EN 1973, ÂGÉ SEULEMENT DE 58 ANS, JEAN-MARIE SERREAU NOUS QUITTAIT
(Acteurs n°13 - mai 1983)Brecht, Beckett, Genet, Adamov, Ionesco, Vinaver, Dubillard, Duras, Frisch, Césaire, Kateb : les plus grands noms du théâtre moderne. Et j'en oublie. Jean-Marie Serreau les a tous joués, révélés. Le premier, souvent ; à leur commencement, toujours. Avec la plus grande simplicité, la meilleure évidence, sur manuscrit, sur commande. D'instinct et avec une exacte lucidité. En avance sur tout, sur tous. Prodigieux.
Plus de quarante mises en scène en vingt-cinq ans. Combien au juste ? Il ne se souciait pas de s'en souvenir. Aucun sens du calcul, de l'archive. Seul le présent, l'avenir l'intéressaient.
La joie, la jubilation, l'exaltation de la vie : il possédait ces dons les plus rares.
Il fut un homme libre, libre de pensée et d'action. On le lui fit payer cher, jusqu'à la pauvreté (qui l'entendit se plaindre ?), jusqu'à devoir se soumettre à des conditions de travail injustes qui l'ont empêché souvent de réaliser ses projets, « donnant » des pièces qu'il avait mises au monde, interrompant des répétitions, créant avec des moyens dérisoires.
Son très exceptionnel talent de metteur en scène, cette façon d'assumer la création dans son entier, ce sens évident de l'espace et de l'architecture scéniques sans cesse approfondi, apuré, exemplaire. Et ses recherches, ses explorations multiples.
Il reste un exemple, un modèle. Parmi nous.
ÉDITORIAL : L'AUTEUR - LE NOUVEL ÂGE
(Acteurs n°13 - mai 1983)Jean-Claude Grumberg interrogé par « Tous en scène » FR3 déclarait à propos de sa pièce L'Indien sous Babylone (qui n'a pas marché, dommage, le spectacle était de qualité) : « Quand je dis que je suis joué à l'Odéon, chacun pense que c'est au Petit-Odéon ; il ne lui viendrait pas à l'idée qu'un auteur contemporain puisse avoir accès à la grande salle de l'Odéon. » II dit aussi — en substance — que « le manque d'intérêt pour les auteurs est tel qu'à chaque pièce on le redécouvre, on redécouvre jusqu'à son existence même ; on reste ainsi éternellement un « jeune » auteur, passant sans transition de l'adolescence à la sénilité, sans que jamais on reconnaisse à l'auteur de bientôt cinquante ans que je suis, un statut, une maturité ».
Cette protestation est vraie. Elle est d'autant plus frappante qu'elle vient d'un de nos meilleurs écrivains de théâtre. Elle est forte parce qu'elle remue un ensemble de questions complexes, difficiles, ambiguës, qui portent sur : le statut de l'auteur, son rôle, la fonction du texte, les rapports entre l'auteur et (les acteurs et) le metteur en scène.
Comme si les auteurs dramatiques de cette époque-ci (depuis une génération) avaient à « payer » de surcroît le rôle impérial que jouèrent pendant un siècle leurs prédécesseurs (et en abusant autant que les metteurs en scène d'aujourd'hui). Jusqu'à la fin des années 50 en effet, la « mise en scène » était marginalisée ou effacée. On n'en trouve pas toujours mention sur tes affiches et les programmes (un « grand » sociétaire — Aimé Clariond —polémiquait en 1954 au Français pour que son travail de metteur en scène et sa signature ne soient pas signalés au public).
En ce temps-là, l'auteur mettait lui-même en scène. Cela se résumait à : 1) établir la distribution avec le directeur du théâtre choisi, 2) faire exécuter littéralement les indications scéniques du texte pour construire le décor, 3) diriger les acteurs en répétitions selon les significations du texte dégagées par l'auteur lui-même, 4) rythmer au final la représentation dans un temps donné.
Plus que d'une réflexion théorique ou d'un raisonnement, c'est des progrès techniques et plus précisément du prodigieux développement de l'outillage lumière (on est passé du gaz au laser) que la mise en scène est née. Certes, ont été déterminants les mises en forme de Craig et Appia, la toilette d'épurement de Copeau, la théorisation de Brecht par Brecht, et les « coups » récents de Ronconi-Grotowski-Bob Wilson.
Le résultat est connu : le théâtre est aujourd'hui pris en charge non plus par l'auteur du texte-écrivant-dirigeant, mais par le metteur en scène-auteur du spectacle-illustrant. Nous en sommes à cet âge-là du théâtre, inutile de s'en offusquer, ou d'ouvrir le dossier nostalgie... C'est un fait, le metteur en scène est celui qui impose l'image et le langage scéniques, digère et restitue pour faire une synthèse de tous les éléments d'un spectacle dont le texte est (seulement) une des parties.
Il va de soi que l'auteur en souffre. Car il est peu ou mal considéré (on est Beckett ou rien). Il ne fait pas le deuil d'être mis au rang des autres intervenants... Ce deuil est-il possible ? Voilà le drame du dramaturge : créateur premier, initial, sans qui tout le projet et tout le spectacle à venir ne seraient et ne se pourraient, l'auteur ne peut admettre une sous-estime, une mise a part, lui qui est une sorte de père-dieu originel. Il sent l'injustice... Ajoutez qu'il vit mal généralement du théâtre, et vous avez tous les éléments d'une mise en crise des auteurs.
Les auteurs : ils existent. (On dit qu'ils ne sont pas, qu'il n'y a pas, plus d'auteurs : suprême négation, suprême blessure.) Comment faire pour qu'ils vivent mieux ? Laisser du temps au temps pour que l'arrogance des metteurs en scène naturellement s'érode — c'est en train de se passer. Attendre que le public, seul juge à la fois de tout, oriente les choix Alors on tendra à un rééquilibre des fonctions de tous les intervenants, à commencer par celle de l'auteur.
ANNIVERSAIRE : IL Y A VINGT ANS : « CRIPURE »
(Acteurs n°12 - mai 1987)II y a vingt ans - déjà. L'étudiant que j'étais alors et qui apprenait le théâtre pas à pas découvrait la version scénique que Louis Guilloux avait lui-même tiré du Sang noir. Cripure a été une de ces étapes qui marquent, font plonger loin en soi et changent quelque part en une soirée le rapport au monde. Un de ces liens émotionnels qui soudain se fixent et ne s'effacent plus.
Cripure aux Marronniers, puis salle Gémier à Chaillot, en 1967, réunissait Marcel Maréchal (Cripure est, je le crois, son plus grand rôle, autant que Bada, par lequel il a achevé d'établir un style, une poétique, une ferveur inégalables) et Tatiana Moukhine (tout simplement sublime), en un de ces couples de théâtre faisant légende.
Cripure - plusieurs fois repris ensuite, par les mêmes évidemment - était un spectacle bouleversant, mais aussi un acte juste « politiquement », une prise de position, un jeu sur l'engagement et le quoi-faire-de-soi d'une grande générosité. Comme le théâtre peut en offrir rarement ; sans théorie, sans dérision esthétisante, sans complaisance...
Sitôt après Cripure, vint la reconnaissance, par le ministère de la Culture, de la Compagnie du Cothurne comme « troupe permanente subventionnée ». Jusque-là, depuis sept ans, Maréchal œuvrait en compagnie privée. Il avait créé Audiberti, Limbour, Marlowe, Vauthier, Ruzzante, sans un système de subvention... Autres temps, autres mœurs.
ÉDITORIAL : MARGE ÉTROITE - Malaise du Théâtre
(Acteurs - mai 1995)Le malaise, le mal de vivre dans le monde aujourd'hui, avec l'accélération que produisent depuis deux ans tant de changements fondamentaux, s'accompagnent de bouleversements, d'éclats, de chantages, de menaces, de guerres, de toute une violence aiguë et multiforme qui s'exerce sur la vie de chacun de nous chaque jour. Il traduit ou signale une défaite des idées(-ologie), des repères, sinon des refuges construits tout au long de ce siècle.
L'invasion extraordinaire des usines à images appelées médias dans l'état (démagogique, vulgaire, nivelant) qui est le sien se révèle déjà un peu plus archaïque chaque jour et laisse deviner une intrusion, une domination future dont on ne mesure pas l'ampleur.
Ce désordre accéléré que nous vivons rend surtout sensible un émiettement des choses de l'esprit. Nous n'en gérons plus, fragmentés, isolés, que des éléments épars, des réflexions à court terme, nous nous croyons obligés de rester reliés à l'événementiel immédiat, aux intérêts et aux profits à vivre au jour le jour, à toute une masse sitôt formée sitôt évacuée de faits dont on ne perçoit plus les priorités, non reliés ensemble, éprouvés à chaud, sans causalités. Et sans mémoire.
Au théâtre, on ne peut dans une certaine mesure que subir indirectement l'effet d'une telle avalanche d'informations traitées en surface, d'un tel assemblage impromptu de signes, et de tant de pauvres preuves d'un vécu traité sans distance par des télévisions, et aussi, à moindre échelon, par des journaux progressivement condamnés eux aussi à l'événementiel à tout prix (parfois au prix du tirage abusif, du faux).
Le spectateur de base subit insidieusement ce torrent factuel sans apprêts, déversé sur lui avec régularité. Il acquiert peu à peu des comportements « culturels » autres, nourris par la facilité, la rapidité, l'intérêt à soutenir sans cesse, le suspense obligé, le sens de l'ellipse, la pratique d'un certain sens mental du « montage » qui ne laisse pas de temps au temps. Habitué à ces attitudes-réflexes chez soi en permanence, le spectateur aura tendance à les projeter lors de ses sorties-spectacles, dont il ressent de moins en moins la nécessité (d'où la réduction de la fréquentation, au cinéma principalement, sous certaines formes - certaines seulement - au théâtre).
Passons sur une conséquence ordinaire de cette modification de l'information, d'ordre professionnel. Je veux parler de la transformation des modes d'attractions publicitaires, qui engendre la multiplication des attachés de presse, oblige à surproduire des informations nécessairement percutantes pour qui doit présenter un produit. Tout dossier de presse doit jurer que le spectacle qu'il est chargé de défendre est le meilleur, le plus beau, le plus grand, quel qu'il soit. .
Le suivi ne se fait plus guère par les « pavés presse » dans les journaux (ruineux, par ailleurs, en augmentation de prix constante), ni par la critique (à quelques exceptions près, elle s'avère inopérante, sauf auprès des instances subventionnantes et des ministères, ce qui n'est pas mince). L'impact publicitaire puissant, devenu hégémonique, est celui de la télévision, et de la surenchère à laquelle les « animateurs » télévisés se livrent, à ce qu'ils en disent (en quelques mots brefs, mal informés, incompétents le plus souvent). N'étant pas spécialisés, parlant de l'appui d'extraits-flashs piteux, ils annoncent les (plus gros) spectacles de théâtre dans les émissions à grande écoute (comme ils peuvent, parlant de tout, donc de rien, comment leur jeter la pierre ?).
Ceci atteint l'acte théâtral en soi et sous toutes ses formes, et l'image même que le public se fait du théâtre (cf. ce que tant de gens ont longtemps cru qu'était le théâtre, n'ayant pour référence qu'« Au théâtre ce soir »). Le théâtre doit s'accomoder du mercantilisme et du sensationnel. Avec quoi et comment attirer, puis retenir un public avide de rapidité et bombardé de sensationnel ? Comment contenter des artistes engagés dans un spectacle, gagnés eux aussi par le besoin d'une réussite en forme de scoop ? Que reste-t-il de la déontologie professionnelle, quelle est encore sa place, peut-elle parvenir à « moraliser » le sensationnel, à le relier à une histoire antérieure ? À une mémoire tout court, qui permet de réfléchir, d'évaluer ?
Un des effets secondaires est aussi la déculturation. On sait apparemment de moins en moins de choses. Autant côté public que côté artistes (ou chez les journalistes stagiaires débutants) ? La question, comme le soulignait il y a peu Jean Tardieu, c'est que les mots, comme jamais, ont perdu leur sens, c'est que le dialogue est un faux dialogue (on ne pose plus de vraie question dans l'attente d'une vraie réponse). Ce non-savoir, cette non-mémoire réduisent la réflexion, laissent démuni, produisent un état d'indifférence et d'angoisse, un goût pour le plus consommable... sans risque, sans difficulté.Enfin, et c'est le plus fâcheux, car on touche ici à l'une des fonctions vives de l'art théâtral, tout cela atteint la dramaturgie (écriture) et l'image scénique (mise en scène) contemporaines. Auteurs et metteurs en scène doivent faire face, tantôt pour compenser, tantôt pour s'en inspirer, à tout ce back ground de sur-information et de sous-culturation. Le réel, le quotidien n'ont plus le même usage, l'actualité et le « moderne » n'ont plus la même place dans la forme, mais aussi dans le fond, des œuvres théâtrales qui s'écrivent aujourd'hui.
Mais dans toute situation de transition, et celle que nous supportons l'est exemplairement, dans toute cette énergie destructrice ou dans les forces qui détournent de l'essentiel, il y a, au fond, en devenir, le contrepoint, sinon le contrepoids prêt à surgir, et dans lequel de nouvelles conditions d'exercice de notre art vont prendre forme, s'affirmer et générer une dynamique nouvelle.
ÉDITORIAL : L'IMAGINATION N'A PAS DE FORME...
(Acteurs n°93 - 1995)
Dix années durant, prendre la parole en cette place a consisté, tout compte fait, à apprendre le doute, à poser des questions, à évoquer des problèmes aussi clairement que se peut tout, à souligner la complexité des sujets et l'incertitude des solutions.Que la question posée soit claire, et, si des réponses sont proposées, gardons-nous de les croire les seules valables. Les écrits sur le théâtre se font de plus en plus abondants ; on publie beaucoup, donnant réponse à tout. Avec toutes les réponses, essayons de faire des questions. Il faut remettre en cause. Écrire un éditorial, c'est se faire Interrogateur. Ce n'est pas, pour autant, pratiquer le doute méthodique, ni contester tout ce qui bouge et qui vit.
Relire les éditoriaux, depuis le premier, il y a dix ans, qui définissait la « politique » de la revue et le territoire où elle allait se situer — qui n'ont jamais varié —, est une rude tâche. Tout semble trop peu ; les questions se répètent (les gens de théâtre ou les tutelles ne trouvant pas les solutions). Peu à peu, un point de vue se dégage, souvent maladroit, trop soumis à une actualité rapide, mais que la résurgence des thèmes et des questions rend cohérent.
C'est le genre qui le veut : le ton est souvent revendicatif, protestataire. Bien souvent, et en me remémorant les nombreuses réussites chaque saison, j'ai regretté de n'avoir pas suffisamment exprimé « l'actif » (les satisfactions, les joies, les enthousiasmes) et cédé au « passif» (ce qui ne va pas ou pourrait aller mieux).
De quoi dresser une sorte de cahier de doléances.Le ministère de la Culture a manqué d'audace et d'imagination en matière de théâtre depuis 1981. Le gouvernement socialiste, la personnalité même du ministre autant que du directeur du Théâtre et des Spectacles attiraient les symphathies, ou l'enthousiasme. Le dialogue avec les professionnels et, mieux encore, les syndicats, était ouvert. Tout aurait pu être tenté. Or, aucune réforme profonde n'a eu lieu. On n'a pas remédié aux problèmes de fond ; ce ne fût que cautère sur jambe de bois, contournement en mineur et en douceur des problèmes qui auraient demandé des options franches et fortes.
On a attaqué en biais les Nationaux, créé une entreprise remarquable, le Théâtre national de la Colline, et une vitrine dite Théâtre de l'Europe (toujours en quête d'identité). On a laissé la Décentralisation s'enfoncer dans l'usure des habitudes et du chacun-pour-soi.
On a fait pire : en apportant au budget de la Culture et du Théâtre une formidable brassée d'argent (au point de friser le 1 %, fameuse et mythique revendication des années soixante-dix), on n'a fait que renforcer l'institution, on a fossilisé la création au profit des charges de fonctionnement, on a conforté les acquis structurels non artistiques.
Pris dans le confort d'une idéologie de principe (qui s'est bien vite défaite), on a laissé aller l'éthique et la morale de l'action et de l'entreprise. On a dévalorisé le rapport au public, pour laisser jouer librement les « montées » à Paris des troupes de la Décentralisation. Jusqu'à une époque récente, on a scandaleusement couvert des déficits injustifiables et assuré des promotions pour des raisons « politiques » bien peu glorieuses.
L'actuel directeur du théâtre a bien du pain sur la planche ; toutes les intentions qu'il a indiquées sont justes et la « moralisation » qu'il a entreprise dans le secteur public a réellement donné lieu à correction. Mais pourra-t-il attaquer les problèmes de front sans une réforme institutionnelle en profondeur ? Cette question est à la base de tout ; elle est l'enjeu premier des années quatre-vingt-dix pour tout ce qui est secteur subventionné.
Le pouvoir de tutelle pourrait être tenu pour seul responsable de l'épuisement progressif de la Décentralisation et du désarroi des Théâtres nationaux. Mais si les hommes de théâtre étaient au clair de leur propre mission et de leur exigence artistique, s'ils décidaient de réagir, l'État serait bien forcé de les accompagner sur cette voie. Ce secteur qui fut, pendant deux décennies au moins, cohérent et solidaire, est devenu au cours des années quatre-vingt un rassemblement hétéroclite de leaders et de plans de carrière (destination finale : la Comédie-Française).
Nous avions consacré le premier numéro d'Acteurs à Jean Vilar. C'était alors aller à contre-courant. Nous aurions pu faire du prochain numéro un hommage au fondateur d'Avignon et du TNP. Aujourd'hui, on le fête, on en fait une image officielle. Tout le monde (donc personne ?) prétend s'en inspirer, vante ses choix, sa morale, son éthique. Attendons les actes. Ainsi va le monde...
Hors secteur, et même parfois à l'intérieur du sérail, restent quelques artistes Convaincus de leur démarche, sûrs de leur action, soucieux de leur rapport au public, engagés dans la pratique de leur production. Ils ont nom (nous les retrouvons à chaque pas en relisant les quatre vingt-dix numéros de la revue) pour n'en citer que quelques-uns, Ariane Mnouchkine, Patrice Chéreau, l'ami Maréchal, Alain Françon, ou Peter Brook - dont, inlassablement, j'inscris une petite belle phrase : « l'imagination n'a pas de forme » en exergue à chaque éditorial.
L'imagination libre, c'est du côté des compagnies indépendantes qu'il faut la chercher. Longtemps, tout s'est passé comme si les barons du secteur public étouffaient la relève. Les jeunes metteurs en scène n'osaient pas, ou imitaient. Sans être sûr qu'une génération nouvelle se dessine bien, comme on voudrait maintenant nous le faire croire, nul doute que des personnalités nouvelles ont fait preuve d'ambition et d'originalité (de Schiaretti à Braunschweig, à Vigner).
Si l'on en vient au secteur privé, on peut s'interroger sur un archaïsme des productions ou sur le recours aux « vedettes », à partir de qui tout se détermine. Et, en contrepoint, sur la mise à l'écart de l'auteur, qui, dans les théâtres privés, avait été jusqu'ici le moteur, le point de départ de la création.
Le secteur privé, se porte sans doute mieux que les entreprises publiques, et ce, grâce au remarquable Fonds de soutien (mis au point par le Ministère Duhamel/Clermont-Tonnerre), parfaitement efficace, parfaitement géré. Preuve tangible de cette bonne santé : le public augmente régulièrement.
Un des traits les plus évidents qui ont marqué ce secteur (quasi-exclusivement parisien) a été la collaboration de plus en plus développée entre directeurs ou producteurs du théâtre privé d'une part, et les animateurs du secteur public d'autre part.C'est Roger Planchon qui a enfoncé le clou ; ses co-réalisations avec la Porte Saint-Martin, le Montparnasse, Mogador ont été des réussites, et la question du versement de la taxe para-fiscale fut réglée à cette occasion. De Daniel Benoin à Jean-Louis Thamin, de Jacques Weber (qui a passé la presque totalité de la saison dernière à Paris, à la Porte Saint-Martin et au Renaud-Barrault) à Marcel Maréchal (co-produisant avec Jacqueline Cormier la reprise à Paris de Glengarry Glen Ross ou, bientôt, la création de Filoumena Marturano de Filippo)... jusqu'à la Comédie-Française accueillie à Montparnasse ou à la Porte Saint-Martin et au Théâtre national de Chaillot faisant reprendre ses spectacles à Mogador, il est maintenant avéré que les frontières entre les secteurs privé et public s'estompent, après avoir été, dans les années soixante et soixante-dix, aussi radicales que le mur de Berlin.
Un des paradoxes récents est que la quantité de classiques augmente sans cesse, et a produit d'éclatants succès (la plus forte recette de Paris à l'automne fut celle du Misanthrope avec Weber et Béart). Molière ou Marivaux, par exemple, sont fréquemment choisis par les « vedettes » des théâtres parisiens, qui hésitent à s'engager dans une création forcément plus risquée. Ces reprises prennent la place des pièces nouvelles. Où est la cause, où est l'effet ? Est-ce parce que peu d'auteurs écrivent pour le Privé, où y-a-t-il peu d'auteurs parce que les places sont prises et qu'il est devenu harassant pour un auteur de se faire jouer ? (Roussin, à la fin de sa vie, disait : « il me faut un an pour écrire une pièce et deux ans pour la faire jouer »).
Pour ce qui est des théâtres eux-mêmes, Paris reste la ville où résistent le mieux les directeurs-producteurs-concepteurs, celle où l'on fait le moins « garage » (Broadway est un vaste cimetière de salles louées au plus offrant). C'est tout à l'honneur de ces commer-çants bravaches, imprudents, tenaces, plus audacieux qu'on ne croit (ah, le confort du
directeur d'une entreprise subventionnée), ces sortes d'aventuriers que sont les directeurs de ces entreprises en nom personnel, où un insuccès est payé sur ses biens propres.Le renoncement d'un Lars Schmidt (qui fît du Montparnasse un théâtre de création admirable), la disparition d'un Jean-Michel Rouzière, la mise en retrait de Jacqueline Cormier renonçant à Edouard-VII, la mort de Marie Bell confirmant l'incohérence de la programmation du Gymnase trop souvent voué aux one-man show... et le déclin (dramatique, disons-le) de cet extraordinaire foyer théâtral que rut le théâtre du Rond-Point Renaud/Barrault auront marqué ces dix années ; cela a créé des manques.
Dépassant la question des institutions, le problème le plus souvent traité est celui de la disharmornie qui existe dans la pratique théâtrale. Plus particulièrement, entre le metteur en scène et l'écrivain de théâtre.
L'auteur dramatique d'aujourd'hui est certainement le moins bien traité dans la création théâtrale. Économiquement, stratégiquement, éthiquement. L'auteur est généralement un laissé pour compte. Quand on le joue, il devient la cible d'enjeux qui le dépassent (imaginez un peintre à qui l'on infligerait la comparaison avec Raphaël ou Vermeer ou Picasso). Sans compter que des gémissements corporatistes (il est bien mal représenté et défendu) et la réclamation (nostalgique) de son ancienne souveraineté le desservent.
Nous avons souvent plaidé pour que les trois métiers de base (auteur, acteur, metteur en scène) se rééquilibrent. La création au théâtre — c'est là sa grandeur et son originalité — est un travail d'ensemble, qui, pour sa réussite, a besoin d'harmonie.
Alors, associant la forme et le fond, la beauté formelle égalera la puissance et la clarté du sens, la joie rejoindra l'intelligence. Alors, on parlera d'artiste authentique... « Celui qui ouvre dans les murs de la prison humaine quelques brèches pour la respiration des captifs »...
On rejoint ici le choix (qui n'a jamais été remis en question) de pratiquer dans Acteurs une critique positive. Faire silence sur quelque chose ou quelqu'un vaut désapprobation, cela suffit. Privilégier une « critique de l'admiration » qui approfondit, nourrit, justifie le goût et l'estime, au détriment d'une « critique du dénigrement ». La première dégage les beautés et les subtilités, relie les signes, précise les niveaux de sens qui se dérobent ; la seconde, forcément, reste à la périphérie, ou fait redondance, elle pousse, à la fin, à une surdité. Si l'on s'est trompé, une admiration mal placée fera sourire, le dénigrement sera porteur d'une violence dans l'erreur, sans appel.
Il en va de même pour les doctrines et les théories. Nous vivons dans une époque où rien ne se disqualifie plus vite que les revendications doctrinaires. Le théâtre récemment en a connu plusieurs, plus radicales les unes que les autres, qui semblent aujourd'hui désuètes et les exécutions auxquelles elles donnaient lieu inconcevables. En art, la clairvoyance est difficile ; gageons qu'on y tend de meilleure façon en recherchant le positif
Aimer admirer, aimer vouloir le dire, aimer entraîner d'autres que soi aux spectacles que l'on aime, à des spectacles de création, faire partager une passion du théâtre. J'aimerais que ce soit sensible au fil des éditoriaux des quatre-vingt onze précédents numéros d'Acteurs.
Il est de fait que, dans les théâtres privés et publics, saison après saison, à un public (qui augmente) est offerte une très extraordinaire quantité de spectacles, une possibilité de choix considérable, de beaux et grands moments de théâtre. D'évidence (j'en témoigne, voyageant beaucoup), nous sommes aujourd'hui le pays le plus nourri et le plus créatif en matière de théâtre (il l'est même trop, devenu babélique), autrement plus que Londres, Berlin, ou New York.
Les manques, les excès, les travers, les déséquilibres, relevés bon an mal an, ne sont en aucune manière une façon de désespérer en quoi que ce soit. C'est la richesse extraordinaire de notre théâtre qui pousse à être exigeant, et à vouloir que tant de talents, tant d'initiatives, tant de réussites reçoivent le profit qu'ils méritent.
Avec le poète, « réjouissons-nous du jaillissement des sources innombrables »...
(Comme le dit Hugo) « descendant, réveillé, de l'autre côté du rêve »...C'est sur ce bilan résolument positif, et même optimiste, que nous abordons la nouvelle décennie.
UNE DRAMATURGIE DU PASSAGE
Nous vivons un temps de mutation, situé, comme le dit Edgar Morin, entre « un monde qui n'arrive pas à mourir et un monde qui n'arrive pas à naître, d'où un état hybride, ambigu, non décisif, état mixte que l'on peut qualifier de Moyen Âge moderne, marqué par la décadence d'une légitimité culturelle sans qu'il y ait affirmation d'une nouvelle légitimité ».
Le Théâtre d'aujourd'hui (comment faire autrement ?) se vit de façon brouillonne ; il se cherche dans tous les sens. Mais, en dépit d'une situation économique désastreuse, la production théâtrale ne cesse d'affirmer sa vitalité. Il existe un théâtre de crise, non pas une crise du théâtre.
Le Centre National de Création Contemporaine, créé, pour un premier parcours de cinq ans, en Juin 1975, s'est engagé, au plan théâtral, dans les incertitudes, voire les contradictions de ce que Jean-Marie Serreau appelait les « dramaturgies du passage », au plan du sens et de la forme.
La première mission que nous nous sommes fixée est de s'engager dans la réalité du présent, d'en affronter le désordre. Non pour affirmer telle ou telle issue, mais pour avancer les moyens d'une connaissance, d'une action dans le sens d'une transformation. Revendiquer ainsi la mise en rapport directe du théâtre à une société. Nous croyons que l'une des démarches les plus actives du théâtre consiste à s'éloigner des conforts passéistes, à approcher au plus près le « reflet du réel », à se lier à l'histoire de notre temps. Artistes et publics seront plus créatifs, mieux participants par le fait d'un « théâtre au présent », exprimant de la réalité ces deux, trois choses (ou plus) que nous savons d'elle...
Choisir de cerner l'analogie du monde où nous vivons et du langage théâtral infléchit l'ensemble de la production, de l'action d'une entreprise.
Un travail théâtral accompli suppose toujours une cohérence de style de la représentation, une harmonie entre les diverses fonctions scéniques, qui se pratiquent de façon inégale aujourd'hui. L'art de la mise en scène - qui est le fait essentiel du dernier demi-siècle - a imposé une sorte de diktat sur les participants à la création théâtrale, surtout quant à l'écriture dramatique, par suite d'une espèce d'impuissance des auteurs à imposer les données d'une écriture moderne. Au plan de la dramaturgie, le théâtre n'a pas connu de renouvellement équivalent à ce que Godard a apporté au cinéma ; il est décalé par rapport aux actuelles recherches littéraires et poétiques par exemple.
Ce constat, très sommairement évoqué ici détermine le second objectif du Centre National de Création Contemporaine à ce stade de son existence : prendre en considération les modes et moyens de l'écriture au théâtre, ceux du langage, de « la langue que nous habitons » d'où une règle : ne crée que des œuvres inédites d'auteurs vivants de langue française. Tout en se démarquant à la fois d'un « théâtre de texte » radicalement dépassé et d'un » théâtre d'auteurs ». (comme le Royal Court anglais). La proposition consiste à encourager les recherches en matières d'écriture ; l'auteur, créateur initial de toute proposition scénique participant à tous les stades du travail théâtral.
Sur ce plan, le Centre National de Création Contemporaine agit d'un point de vue économique et professionnel, en salariant les auteurs et en assurant la production d'œuvres inédites (six commandes sur dix créations dès cette première saison, seulement des premières pièces l'année prochaine) (3). Aussi et surtout, par la constitution d'ateliers, qui deviennent le support de toute l'activité du Centre : auteurs et metteurs en scène seront associés à tous les moments du travail, depuis celui de l'écriture, dès le départ, jusqu'à la présentation du spectacle au public, ainsi que dans les prolongements possibles de l'acte théâtral (manifestations extra-théâtrales ; animations ; réflexions en liaison avec des revues, des centres universitaires, des organisations professionnelles ou politiques, des représentants du public).
Nul ne peut préjuger des formes exemplaires du langage théâtral de demain. Mais il faut risquer des propositions, s'y aventurer, affirmer le droit à l'erreur. Tout cela à la mesure des forces d'une équipe et des ressources (insuffisantes) de l'entreprise.
Coopérative Ouvrière de Production, le Centre National de Création Contemporaine gère son budget artistique avec la participation des équipes de création. Pour des raisons de commodité la première saison, les créations du Centre ont été faites dans le cadre des deux salles (800 et 200 places) du théâtre Le Palace à Paris. Mais il n'existe aucune coïncidence entre les entreprises (séparées) du Centre National de Création Contemporaine et du Palace, seulement une même direction. (4). Dès la saison prochaine - cette option devant être accentuée par la suite, sinon radicalisée - le Centre National de Création Contemporaine interviendra hors du Palace (une exception déjà : La Passion du Général Franco est actuellement créée dans le volume libre de l'un des entrepôts Calberson). Telle ou telle création peut exiger d'être réalisée dans un espace et selon une scénographie spécifiques, éventuellement un lieu non spécifiquement théâtral, engageant ainsi de nouveaux rapports au public.
(3) Étant donné la rapidité de constitution du Centre National de Création Contemporaine, la première saison fut conçue comme une saison de transition faisant voisiner des auteurs consacrés dont l'œuvre est pour nous essentielle (Armand Gatti,. Georges Michel, André Benedetto , avec de premières expériences d'écritures (de Jean-Pierre Sarrazac à Jean-Marie Patte).
(4) Le Théâtre Le Palaceest un théâtre non subventionné, de statut semblable aux théâtres privés parisiens Le Centre National de Création Contemporaine à but non lucratif s'interdisant de jouer un spectacle plus de soixante fois, a reçu, en 1976, 1.800.000 F de subvention de État, pour dix créations totalisant au moins 350 représentations;
PARLER N'EST PAS JOUER
(mars 1985)C'est une petite mode du jour : on préfère ne pas jouer les pièces et prendre les risques d'une création. On en fait des lectures publiques, et on en parle, on en bavarde.
On dit que l'on manque d'auteurs. En France... Car aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, les générations d'écrivains se succèdent... Par contre, nombreux sont nos para-écrivains, « analystes » de dramaturgie générale, commentateurs professionnels de l'écriture théâtrale.
Ce type de discours remplace trop souvent les œuvres mêmes : on se dit que ces commentateurs pourraient peut-être (qui sait ?) un jour les écrire eux-mêmes. Cet exercice intellectuel provoque de vraies satisfactions (universitaire, je fus). Mais c'est sans aucune mesure possible comparable avec l'enjeu, la joie, le peur, l'intensité de vie que procure l'acte d'écrire et la représentation théâtrale d'un texte. Commenter une dramaturgie ou se réduire à la lecture d'une pièce, c'est éviter « l'épreuve » - épreuve au sens de : éprouver ; épreuve au sens de : risquer. On ne peut pas imaginer, sans l'avoir vécu, à quel point une pièce représente une vraie part de vie. On ne peut pas imaginer la provocation enthousiasmante et intolérable, rigoureusement invivable qu'est la mise en relation avec le public de cette pièce - matière vivante (Madeleine Renaud rappelait récemment que Samuel Beckett n'a jamais pu aller s'asseoir parmi les spectateurs d'une représentation de Oh, les beaux jours, durant vingt-trois ans).
Je le dis, très simplement, jamais un classique ne me donne, en tant que spectateur, le plaisir très profond d'une pièce neuve, écrite aujourd'hui. L'Illusion ou Richard II ne vaudra jamais, prenons un exemple récent, Été de Bond. Pour une fois un texte âpre, au langage précis, à la poésie violente nous donne à voir le chant de notre temps, de notre Histoire. Sa puissance même divise, exclut l'unanimité. Comme cela s'est joué à Créteil, sans « vedette », sans tintamarre, le public a été difficile à mobiliser...
Écrire quoi et comment, aujourd'hui ? Aucun colloque ne le dira. À chaque écrivain de répondre. Un texte dramatique neuf est un objet par excellence barbare, dont on a du mal à parler d'avance — alors qu'on préfère promotionner une mise en scène non encore faite... Alors même qu'une mise en scène peut transformer, déformer un texte, lui donner une forme à laquelle il ne saurait être réduit... Mettre en scène une pièce pour la première fois est un lourde responsabilité.
Il faut bien avouer que cette responsabilité ne semble pas bouleverser beaucoup de metteurs en scène. Étant donné la surenchère internationale (à Paris plus qu'ailleurs) des mises en scène de prestige, toute pièce inédite est livrée à une extrême incertitude (une raison pour laquelle il y aurait en France moins d'auteurs...).
Il faut bien avouer que ne pas « reconnaître » sa pièce à la scène est une épreuve pas banale qui ne prédispose pas à la récidive. J'ai été directeur de théâtre pendant dix ans, et malgré mes soins attentifs, j'ai yu des auteurs désolés et ai déploré leur désarroi. Il arrive qu'un auteur ait la possibilité de choisir librement une production, le ou les théâtres où sa pièce sera jouée, le metteur en scène, les acteurs, il semble assuré alors que le produit final sera « conforme ». Cependant la déformation de l'oeuvre est encore possible. C'est la grandeur et l'angoisse du théâtre. Évidemment un auteur a le droit légal d'empêcher les représentations de sa pièce. Évidemment il ne le fait (mais j'ai vu Genet faisant interdire par la police, malgré l'intervention de Sartre, une pièce dans mon théâtre ! Et j'eus un jour la plus grande peine à empêcher Audureau de faire de même).
Que faire quand les acteurs sont magnifiques, mais qu'une idée de mise en scène (sorte de Docteur Frankenstein dépassé par le monstre qu'il a créé) impose au texte un autre sens ? Passer outre ? S'avouer que, somme toute, sa pièce contient des ressources ignorées ? Se désespérer, ou tenir bon en se disant qu'on traduit sa pièce à l'étranger ?
Autant d'épreuves qui forment le caractère, ou découragent. Comment faire face — il est évident que la solution n'est pas que les auteurs en viennent à se mettre en scène eux-mêmes ? Comment résister et ne pas glisser vers le cinéma ou la télévision, ou la BD ? J'ai connu un auteur qui a compensé en s'en allant créer un groupe rock ! Un autre, en voyageant...
Pour un auteur, ainsi va le monde. Un monde où même la sœur de Shakespeare ne reconnaîtrait plus le sien.
ÉDITORIAL : « L'IMAGINATION N'A PAS DE FORME » (Peter Brook)
(Théâtres - septembre 1985)Je me réjouis de la phrase toujours mise en exergue à ces éditoriaux : « L'imagination n'a pas de forme », a dit, un jour, Peter Brook. Ces quelques mots n'ont l'air de rien, et pourtant, ils sont tout : tout ce qui sert à définir un véritable artiste, une véritable pratique, une indépendance vis-à-vis des pouvoirs et des commentateurs de tous ordres dont on regorge. Et cette phrase de Brook peut, doit s'appliquer avant tout aux auteurs. Pour ces êtres-là, oui, il n'est pas concevable que l'imagination soit « coulée », « moulée », ni qu'elle soit formalisable, repérable ; alors même qu'elle est une imagination exacte, dessinée sur papier, celle qui crée en premier, avant que n'arrivent l'interprète et son maître en scène...
ÉDITORIAL : TRANSLATION
(Théâtres - janvier 1986)Translation est un mot français et l'on sait ce qu'il signifie. C'est aussi Un mot anglais qui a deux sens : le même qu'en français (qui indique le mouvement, le glissement, le déplacement), et
aussi : traduire. Ce mot, par ses sens, pose bien le problème du passage d'une pièce d'une langue ; « étrangère » à une autre.« La langue que nous habitons... » avait coutume de dire Jean-Marie Serreau pour cerner le territoire culturel d'un pays — ce n'est pas la nationalité, ni la race, ni la couleur, mais la langue, -avec la culture qu'elle contient, qui donne « part et proportion ». Dès que nous changeons de langue, nous déménageons. Traduire, c'est déménager. C'est prendre soi, son espace vital, sa
mémoire de vie, au présent et au passé et les implanter autrement, les réordonner, les redisposer. C'est donner un nouvel air, une. nouvelle manière, parfois s'il le faut une autre façon - d être, une autre dimension, en se greffant sur terrain inconnu.II ne faut pas refuser ni nier la différence qu'implique la traduction. D'autant plus si un auteur est nouveau, pas encore repéré, si; on se sent désorienté par sa personnalité et son style.
Un texte étranger n'est bien rendu dans une autre langue qu'en conservant son étrangeté, son authenticité d'origine. Plus une pièce américaine restera « américaine », plus une pièce russe restera « russe » et plus cette pièce atteindra à l'universel à travers sa spécificité même.Je ne connais rien de pire que ces adaptations larges, ces transpositions déformantes qui changent temps ou lieux de l'action, pour que « ça coule », Traduire ne signifie surtout pas - transiger, en parvenant à une sorte de « plâtéen » prétexte à réussite commerciale,
II faut aller jusqu'à admettre qu'il existe des « choses » intraductibles, qu'il y a et qu'il doit demeurer un écart, une sorte de « no man's land » sans équivalence stricte.
Si l'on ne peut s'en convaincre, alors il faut refuser toute traduction et n'écouter Sophocle, Shakespeare, Pinter, Tchekhov, Botho Strauss, qu'en grec, anglais, russe ou allemand.
Il est saisissant de l'éprouver pour soi-même, dans l'autre sens. Passionnant de voir ses pièces traduites en américain (par David Mamet ou Emily Mann) ou dans des langues « particulièrement étrangères » telles que l'arabe, le finnois ou le chinois... Et troublant de repérer sur soi le déplacement obligé, l'impossible exactitude, ce qui demeure irréductiblement « français »... et aussi, ô paradoxe, ce qui dans le texte passe mieux (plus fin, plus fort) en « étranger »... qu'en français.Le plus extraordinaire est alors de reconnaître dans tous les pays, au-delà des mots et des langages, le Théâtre. Dans toutes les langues, dans tous les pays se retrouvent la dimension universelle des œuvres et leur spécificité. Au nom de l'obligatoire métissage que l'Histoire nous impose. Au nom de la vie même.
ÉDITORIAL : « C'EST EN ÉCRIVANT QU'ON DEVIENT ÉCRIVERON » (Raymond Queneau)
(Théâtres - juillet 1986)Dans son bilan de la saison qui vient de s'achever, Pierre Marcabru (Le Figaro) a raison de souligner la part congrue réservée aux auteurs dramatiques français contemporains et, plus largement, aux pièces nouvelles.
Sans « vedettes », un auteur n'a pratiquement aucune chance d'être créé dans un théâtre privé, fût-il de jauge modeste (le La Bruyère). Or les « vedettes » rechignent aux créations (elles se « risquent » tellement plus facilement sur une pièce étrangère dont on a déjà ailleurs vérifié le succès) et ne tiennent pas à se produire dans des théâtres ne correspondant pas à leur « standing » (...) et à rapport faible (les « vedettes » sont payées au pourcentage de la recette)... Quand on dit cela, les vedettes se mettent en colère : si on leur proposait des œuvres françaises formidables à créer, bien sûr que si, elles iraient dans ces petits théâtres et se résigneraient à jouer les petits pauvres. Voire... À en juger par la capacité des agents et de leurs clients à savoir lire un texte nouveau, il est permis de rester sceptique.
À cela s'ajoute la sévérité de la critique. Comme le public paie sa place et doit être satisfait par un Guitry bien connu (Faisons un rêve) autant que par un Dupont à découvrir, les critiques fonctionnent sans indulgence (il le faut) mais aussi sans incitation, ni encouragement particulier.
Ajoutons que la plupart des metteurs en scène sont aveugles et sourds dans leur rapport aux auteurs et sans curiosité. Il y a de quoi rager : il existe encore des pièces inédites de Ionesco, Yourcenar, Julien Green, pour ne parler que des brontosaures vivants, et pas un metteur en scène n'aura l'idée de leur poser cette simple question : en ce moment, écrivez-vous ? Avez-vous écrit une pièce récemment ? Mais si, cela m'intéresse...
Nous en arrivons au premier des grands motifs qui « gèlent » nos écrivains de théâtre : l'absence d'intérêt, de curiosité, d'estime. Presque tous les auteurs sont maladroits dans leur façon d'entrer en rapport avec les théâtres, peu informés de qui est qui, ils ne savent pas « cibler » ni choisir. Résultat : méconnus (on ne les lit pas), ignorés (on ne leur répond pas), légèrement traités (quand on leur répond), les auteurs ont la vie dure s'ils ne connaissent personne ou ne sont pas en relation avec un groupe, un ensemble, un clan.
Joués, ils montent au créneau ; il faut avoir bien du talent aujourd'hui pour en réchapper, panser les plaies ou éviter la fusillade, l'auteur - qui a tant besoin précisément de confortation et de (re)connaissance - se relève, ou non.Étonnez-vous de ce qu'il aille, victime mal résignée, se faire embaucher dans les usines à scenarii de télévision. Là au moins, il gagne sa vie (même si on l'y traite parfois encore plus mal ! et si le rapport à l'Autorité y est encore plus abusif et arbitraire !). Ou s'égare dans la compensation de trente-six petits métiers.
En outre, situation sociale et crise d'identité mises à part, l'auteur doit faire face à la crise de la fonction du texte. Une pièce de théâtre, encore ? Bof. Une vraie, pièce de théâtre ? Vraiment construite ? Avec des dialogues ? Une action ? Beurk. Ça fait vieux. Comment mettre « ça » en scène quand on a sous la main Sophocle et Shakespeare et Molière ? Quand on a Beckett, un prix nobel ?
Mais oui, gens de qualité. À vrai dire on l'entend moins depuis quelque temps. La mise en scène a tant enflé qu'elle a parfois éclaté. Quant au « retour à l'acteur », il a au moins servi à remettre le texte en jeu - c'est vrai, quoi, il a besoin de mots, l'acteur, et pas de n'importe quoi.
C'est qu'à la fin, les auteurs on les décourage, on les empêche d'écrire, de travailler, de progresser.
Les théâtres subventionnés passent outre leur cahier des charges qui leur impose une création d'œuvre française nouvelle par saison, en truquant par des coproductions à têtes multiples. Le ministère de la Culture devrait y mettre le holà. Et faire un rapide calcul. Avec ce que coûte un décor (de L'Illusion à l'odéon, du Chapeau de paille au Français, de L'Avare à Villeurbanne), combien de pièces nouvelles d'auteurs français pourrait-on créer ? Combien ? Dix, quinze, vingt ?
Vingt pièces nouvelles contre une Illusion ! Que préférez-vous ?
ÉDITORIAL : DISPARITIONS
(Théâtres - novembre 1990)Cette saison, de fait, restera marquée moins par ses événements artistiques que par la disparition de plusieurs grandes personnalités du théâtre.
En tout premier lieu, celui qui fut et restera peut-être l'écrivain de théâtre le plus important de l'après-guerre, Samuel Beckett disparaît après une longue vie, et une œuvre achevée. On annonce, en reprise, plusieurs de ses œuvres la saison prochaine, avec notamment l'un de ses meilleurs interprètes, David Warrilow. Et nombre d'étudiants sont à l'ouvrage dans bien des universités.
Après Beckett, Antoine Vitez et Michel Guy nous ont quittés.
Disparu brutalement, au plus haut de ses capacités et de sa capacité de création, en pleine maîtrise de son talent et de son discours sur le théâtre, Antoine Vitez laisse ses élèves dans le chagrin, notre première troupe nationale dans la stupéfaction, et toute la profession, tous métiers confondus, dans un désarroi diffus. C'est qu'en cette période aucune démarche n'est tenue pour exemplaire, aucun unanimisme n'est possible, il ne se fait aucun consensus, nous vivons dans la division et le conflit, et les lignes sont floues. Un artiste aussi accompli que le fut Antoine Vitez, dans la mesure où il a pu accomplir tout un trajet et s'y exprimer à sa guise, en toute cohérence de pensée et d'action, était devenu un repère fort et généralement approuvé. Il laisse, réellement, un vide.
La mort de Michel Guy, que chacun savait inéluctable, est celle d'un artiste-mécène, haut responsable qui, depuis dix-huit ans au Festival d'Automne, affirmait (non loin de Vitez) une politique de création mise au service du metteur en scène, volontiers élitiste, sinon hautaine, bravant tous les obstacles pour imposer une intuition esthétique intime, ignorant du publuc s'il le jugeait inévitable, faisant glisser vers le théâtre toute une conception du metteur en scène, peintre, seul auteur et seul maître de son espace de création... Michel Guy, dans la foulée du Théâtre des Nations et du Festival de Nancy, fut aussi celui qui affirma la fonction de Paris, point central de la création théâtrale mondiale, en constante rivalité « parallèle » avec Jack Lang.
Les conséquences de cette double tendance sont aujourd'hui perceptibles partout dans le théâtre français. Quoi qu'on en veuille, ce fut décisif. Nous vivons sur cette lancée.
Delphine Seyrig était l'une de nos plus grandes actrices. De celles qui, au meilleur de leur art, doivent avoir pour elles encore, de nombreuses années pour l'exercer. J'ai appris sa mort tardivement, au retour d'un séjour aux USA, où elle était connue là-bas. Quoique la sachant malade, cette nouvelle m'a laissé avec le sentiment d'une perte sans compensation. Avec le regret de tout ce qu'elle n'a pas joué, tant de rôles, tant de pièces. Avec la suggestion précise de cette magie si particulière, si unique - le port, la grâce du geste, la musique de la voix (que les médiocres prenaient pour de l'afféterie), cette espèce de lumière qui l'entourait, qui irradiait son visage, cette intelligence qui explorait et prolongeait le sens profond et la poésie de tout texte et de tout univers auxquels elle se vouait. Un deuil d'émotions et d'admirations mêlées que l'on doit faire quoi qu'on en veuille, quand soudain un acteur disparaît.
Je l'avais un peu connue, dans un appartement blanc de la place des Vosges où, toute de blanc vêtue, tenant un chat blanc dans ses bras, son élégance simplissime m'avait tout bonnement foudroyé ; et plus tard, à partir de Simone de Beauvoir, et de ses activités féministes combattantes. À vrai dire, ces souvenirs, aussi rares qu'ils aient été, n'ont pas compté à l'annonce de sa mort. Ne sont revenus en foule qu'une abondante procession d'images magiques de figurations mythiques — un éclat du regard, l'arrondi du geste, une façon de s'asseoir, une musicalité et un chavirement, un éblouissement d'intelligence se mêlant ensemble. Une brassée de références non datées, perdant leurs repères, unissant La prochaine fois je vous le chanterai à Se trouver, Le Complexe de Philémon à Sarah ou le cri de la langouste, à Duras (qu'elle n'a pas assez joué à la scène) jusqu'au sublime La Bête dans la jungle - merci Seyrig, merci Sami Frey - de La Collection et L'Amant, du Mois à la campagne à L'Aide-mémoire, de Rosencrantz et Guildenstem sont morts à La Chevauchée sur le lac de Constance...
Elle avait exploré avec précaution tous les secteurs (privé et public - elle avait débuté chez Jean Dasté), tous les âges dramatiques (Shakespeare, Tchékhov, mais avec une préférence marquée pour les contemporains), tous les styles (de l'Actor's Studio avec Lee Strasberg au théâtre militant). Elle s'était engagée, elle avait milité. On l'aimait, on la respectait. Une belle vie d'actrice.
Seyrig dirigée par Régy ou par Arias, Seyrig avec Duras, ce fut un miracle.
On ne l'oubliera pas.
Au nom de cette belle carrière de théâtre, saluons tous les acteurs qui aujourd'hui se vouent au théâtre, qui ont fait le CHOIX du THÉÂTRE.
Ce ne sont pas toujours des « vedettes » capables d'occuper les télévisions et les médias, sans lesquels le théâtre aujourd'hui semble ne pas pouvoir respirer. Ce ne sont pas toujours des acteurs de cinéma angoissés par leur box-office et la crise actuelle des films, qui condescendent par-ci, par-là, à « faire leur rentrée au théâtre », et qui sont, toute réflexion faite, la principale charge du théâtre français aujourd'hui. -
Ces Acteurs de Théâtre opposés aux Vedettes de Cinéma sont des artistes conscients de choix réguliers tant au plan des troupes que des répertoires ; ceux-là feront toujours passer leur sens artistique (ou leur goût du succès public) avant un intérêt carriériste épisodique. Ces Acteurs de Théâtre n'ont rien à voir avec ces Vedettes de Cinéma qui font des choix narcissiques, refusent les créations de pièces nouvelles ou renâclent devant les risques (choisissant au mieux tel succès new-yorkais ou londonien déjà avéré), rêvent de jouer un classique pour se faire plaisir, bloquent les distributions des pièces que voudraient bien monter les directeurs de théâtre et ne le peuvent (...? ) sans ces acteurs-là.
Bref, ces Acteurs de Théâtre sont l'honneur de leur profession. Nous leur rendons ici hommage.
ÉDITORIAL : TRAQUER L'EXCELLENCE - Vingt ans au Soleil
(Théâtres - janvier 1991)Je me souviens, alors que commençait ma vie au théâtre, à l'automne 1969, avoir visité en compagnie de Jean-Marie Serreau et d'Ariane Mnouchkine un champ de boue, espace cahotique dénommé Cartoucherie de Vincennes. Lui, avait le projet d'y créer un Théâtre de la Tempête, elle, allait y domicilier un Théâtre du Soleil, deux signifiants choisis dans les Éléments, deux noms éclatants. Ce n'était qu'un « no man's land » comme on les recherchait à l'époque, pour faire du théâtre hors les murs (hors des théâtres, hors des institutions). En fait un tas de hangars, de baraquements mal assurés, désuets, en mauvais état, avec des écuries peuplées de chevaux, aux accès incertains. « Une réserve d'indiens », (disait Serreau), semi-ruinée, à l'écart de tout, où tout, croyait-on, devait être possible. Et ce le fut.
Vingt ans plus tard, la Cartoucherie de Vincennes est un des premiers foyers du théâtre mondial. Outre la Tempête, qui survécut à Jean-Marie Serreau, l'Aquarium, l'Épée-de-Bois, le Chaudron ont trouvé leur place autour du Soleil. Je dis bien autour, car lorsque le Soleil est en activité une animation exceptionnelle agite le lieu et dynamise les autres théâtres. Les pouvoirs publics ont rationalisé le jeu, des subventions (bien qu'un effort reste à faire), et offert des moyens d'équipement. L'endroit a fait toilette. Récemment, les abords et les circulations ont été impeccablement aménagés. Vingt ans déjà.
Fin août 1970, on vit arriver Ariane Mnouchkine, son chariot, ses bagages, et une troupe d'acteurs qu'on avait appris à, aimer (Jean-Claude Penchenat, Joséphine Derenne, Lucia Bensasson, Georges Bonnaud, Louba Gerchikoff, Rosine Rochette, Gérard Hardy... avant que n'arrivent Mario Gonzalès, puis Philippe Caubère, puis Georges Bigot). Ils investissent l'espace des hangars du fond, qu'ils allaient, les transformant sans cesse d'un spectacle à l'autre, rendre fameux.
Rien n'a changé pour ce qui est de la chaleur et de la ferveur. Côté plateau et côté public. L'émotion partagée du public (une des dernières traces de l'unanimisme vilarien), le sentiment d'être traité pour ce que chacun a de meilleur, une impression de gratitude pour l'élégance et la courtoisie de l'accueil, la simplicité même d'Ariane Mnouchkine en hôtesse officiante, tout cela est éprouvé par le public dès l'entrée, puis dans la salle et jusqu'après le spectacle. Cela reste aussi fort aujourd'hui pour Les Atrides, qu'au premier jour pour 7789.
Le public accourt, se bouscule. Alors que d'aucuns se plaignent d'une désaffection du public, il faut voir là ces files d'attente dans le froid et la pluie, dès neuf heures du matin (pour treize heures, heure de début du spectacle) dans l'espoir d'assister aux Atrides en continu le dimanche après-midi. Et tous n'entrent pas. Il faut voir Ariane, éclatant d'une vie éclatante, prenant à témoin pour rendre hommage à cet amour, à cette fidélité du public, qui fonde sa foi dans l'entreprise et sa foi dans le théâtre. Avec raison.
Le Théâtre du Soleil est une île de clarté, de haute inspiration, de lumière. Bertrand Poirot-Delpech, dans son feuilleton du Monde relève « ce précepte que Mnouchkine a pris au pied de la lettre : « Traquer l'excellence... »
Plus d'un million de spectateurs ont fréquenté les spectacles du Soleil en ses murs. Ariane Mnouchkine tient le cap, inébranlable. Charismatique. Épaulée par ses fidèles : depuis quinze ans Guy-Claude François est là pour l'espace scénique et Erhard Stiefel pour les masques ; depuis dix ans Jean-Claude Barriera et Nathalie Thomas pour les costumes, et Jean-Jacques Lemêtre (essentiel !) pour la musique. Hélène Cixous est poète écrivain en résidence : une « Russiade » est annoncée, au printemps.
Les acteurs se sont davantage renouvelés, pour des raisons multiples, qui sont connues (exposées par Ariane elle-même, mieux que par Caubère). Parmi les nouveaux, accompagnés par Bigot, plusieurs ont une personnalité remarquable, ainsi Simon Abkarian, Juliana Carneiro de Cunha, Nirupama Nityananadan...
LE SENS LE PLUS PUR
Un autre, un égal enthousiasme (pour des raisons, finalement bien voisines) nous vient de La Tempête de William Shakespeare, admirablement servie et mise en scène par Peter Brook - une sorte d'aboutissement de son travail plus que trentenaire sur Shakespeare, tel un chef-d'œuvre d'artiste chinois. Oublions le tiédisme de la critique, comme si trop de cohérence et trop d'exigence de style pouvaient lasser (il en a été quelque peu de même pour Mnouchkine) —, en France, on n'aime pas la continuité du succès...
Il est certain que Brook approfondit son style, « nettoie » son ouvrage, affine le trait. Il radicalise son rapport au jeu de l'acteur et à sa fonction par rapport au texte. Saluons, comme chez Mnouchkine, ces acteurs admirables, aux noms incommodes : Sotigui Kouyaté, Bruce Myers, Bakay Sangaré, Shantala Malhar-Shivalingappa... Et, pour ses « décors » et costumes, Cloé Obolensky.
Peter Brook nous révèle, ni plus ni moins, une pièce, une Tempête qui nous était inconnue. En tout, même dans ses parties ou ses dimensions « injouables » (féeriques), la pièce nous est livrée avec une simplicité, une grâce dans la clarté dignes de l'enfance. C'est bouleversant d'évidence et d'inspiration dans la mise en rapport réel/rêve-inconscient. Et comme Brook sait bien raconter l'histoire !
Encore ici, le public se bat pour entrer et acheter sa place. Et doit attendre plusieurs semaines à l'avance.
Décidément la fin 1990 fut vaste.
Dans un registre plus strict, voire limité, on nous annonce un cycle Heiner Müller, le plus passionnant, le plus visionnaire, le moins accommodable des écrivains allemands, auquel le Théâtre national de Belgique consacre deux de ses productions, remarquablement mises en scène par Philippe Van Kessel (La Bataille et Germania mort à Berlin). Le premier acte de cette opération fut (parti de Bobigny) un retraitement, n'ayant rien de commun avec le premier montage de la pièce à Saint-Denis, de Hamlet-machine par Jean Jourdheuil et Jean-François Peyret.
Pour les tenants d'un théâtre de recherche, disons même d'avant-garde au sens littéral, ce travail est remarquable. Surprise et qualité supérieure : jamais un espace scénique aussi amplement contraignant n'avait si bien servi une recherche sur le mouvement, le son, la voix, si peu gêné un texte théâtral. Mieux : ce spectacle est une preuve superbe que des artistes de talent et de rigueur peuvent parfaitement atteindre à l'harmonie, à la complémentarité du texte et de l'image, et à l'intégration du sens d'un texte dans l'espace (autrement que chez Brook et Mnouchkine, mais on pourrait aisément les faire se rejoindre). Nous sommes loin du disfonctionnement de tant de mises en scène à la mode.
ÉDITORIAL : THÉÂTRE EN JEU
(Théâtres 1991-1992)Pendant dix ans, de 1982 à 1992, et cent numéros, la revue Acteurs a témoigné de toutes les formes de théâtre, sans discrimination. Elle a offert le plus grand nombre d'informations dans les divers genres et secteurs du théâtre, en essayant autant que possible de les différencier et d'en dégager, aussi, leurs points communs. L'objectif était de rassembler les données les plus variées, d'accroître les repères, de photographier les composantes et les signes afin de constituer une mémoire du théâtre.
Ce livre s'inscrit dans cette foulée. Il vise les mêmes objectifs. Il est consacré à la saison théâtrale et se veut le premier d'une collection régulière, à paraître chaque année. Mais, à la différence de ce que permet une revue (dont la périodicité oblige à anticiper les résultats des spectacles et gêne les choix et l'évaluation), un ouvrage consacré à la saison théâtrale après achèvement de celle-ci, conçu donc a posteriori, permet de traiter de ce qui s'est produit pendant l'année en faisant preuve de plus de poids et de mesures.
L'intervention d'un nouveau partenariat, celui d'Hachette, élargit en outre l'impact. Théâtre, 1991-1992, dans sa matière comme dans sa forme et dans son usage, doit répondre plus précisément aux besoins d'information de tout un secteur artistique. Il doit aussi et surtout s'adresser à un public intéressé par le théâtre, divers, élargi et moins « professionnel » que celui d'une revue spécifique.
Pendant dix ans, en épigraphe à mes éditoriaux de la revue Acteurs, j'ai inscrit cette phrase de Peter Brook : L'imagination n'a pas de forme.
Je ne me lasse pas de laisser la pensée et l'imagination vagabonder à partir de cette permission de liberté — aussi impossible à cerner qu'un proverbe chinois. C'est une profession de foi en faveur de l'indépendance.
Le théâtre, plus que tout autre spectacle vivant, peut et doit la revendiquer à toutes les étapes de la création : indépendance de l'écriture qui doit être constamment ressaisie pour traduire et expulser, pourrait-on dire, son époque ; indépendance de tous les artistes impliqués dans l'élaboration d'un spectacle ; autonomie de l'imaginaire, hors de tout impératif de doctrine et d' a priori ; indépendance du public, enfin, pour lequel le théâtre est fait (il faut le répéter inlassablement et le faire graver à l'entrée de toutes les salles).
Cette phrase de Peter Brook — si admirablement illustrée par sa propre pratique — reflète ce que le théâtre de notre époque contient de meilleur : une remise en question permanente de l'écriture et de l'image scénique, un foisonnement et un aimable désordre de spectacles, d'ateliers, de bandes, de familles, et même d'institutions qui encouragent la création et la remise en question des formes.
C'est qu'on a vu s'effondrer, dans une indifférence subite, des systèmes théoriques ou des « traditions » consacrées qu'on aurait, il y a peu, assuré de la plus durable postérité. C'est autant une preuve de santé et de liberté, où la création trouvera son compte, qu'un inquiétant signe d'angoisse pas toujours créatrice. Notre époque oscille souvent entre un ordre qui normalise à l'excès et étouffe les individualités les plus âpres, et un désordre sans repères. Cette fin de siècle file son train, saisie par un appétit d'inédit destructeur.
Qui aurait prédit un effacement de Brecht aussi brutal ? Qui aurait imaginé ces hommages voraces à des auteurs dont on a joué les œuvres d'un coup, en entier, comme pour les évacuer ensuite — tels Thomas Bernhard, Heiner Müller, Jean Genet, Botho Strauss — ou bien à des pièces que l'on monte dix, douze fois simultanément, et qu'on remet ensuite au placard, épuisées. Qui aurait dit à la mort d'Antoine Vitez, qui avait tant ému, que la rhétorique envahirait son héritage aussi rapidement ? Bref, l'époque est à la rapidité, à la dévoration massive. Nous vivons des temps anthropophagiques.
La pratique dominante n'a guère, aujourd'hui, d'éthique. Peu se soucient encore de morale et de rigueur. Cela suffirait à nourrir les fureurs d'Alceste. Et cependant notre théâtre est le plus actif et le plus varié du monde. On se réjouit d'initiatives qui foisonnent, de l'accroissement du public, de tant de signes de vitalité pour demain.
Étrangement, ce qui est négatif se conjugue aisément avec ce qui est porteur d'invention et d'audace. Étrange époque, oublieuse, ingrate, violente, et si permissive, si incitative. Ces signes couleur du temps ont marqué le théâtre, la saison dernière.
Il est vrai que la formidable augmentation de l'aide de l'État aux institutions théâtrales depuis 1981 est allée aux charges de fonctionnement et de promotion, davantage qu'à l'accroissement des budgets artistiques. La Direction du théâtre au ministère (avec Bernard Faivre d'Arcier) a très utilement imposé l'assainissement des entreprises du secteur subventionné.
Les théâtres nationaux ne connaissent pas d'embellie, c'est le moins que l'on puisse dire. À la Comédie-Française la troupe manque d'éclat, les productions sont lourdes, le répertoire est restreint (mais la fréquentation de la salle Richelieu est excellente). Chaillot manque de projet. Strasbourg attend la saison prochaine, pour se définir. Quant au théâtre de l'Europe, à l'Odéon, il n'a prouvé sa raison d'être qu'avec un remarquable Temps et la chambre pu Patrice Chéreau (qui n'était pas spécialement « européen ») ; le reste fut insuffisant ; pourtant les moyens ne manquent pas. Le seul théâtre national qui ait prouvé une cohérence, une vitalité indiscutables a été, une fois encore, La Colline, dont Jorge Lavelli a fait le premier théâtre de Paris, un théâtre de création et de découverte de dramaturgies contemporaines, déjà, irremplaçable.
Peter Brook s'est absenté.
Ariane Mnouchkine au théâtre du Soleil reste hors concours. Son œuvre ne cesse d'être magnifique, si claire, si homogène, si droite. Nous la suivons toujours avec le même enthousiasme.
Les spectacles les plus intéressants et les entreprises les plus significatives dans le secteur subventionné, c'est en proche banlieue qu'il a fallu les découvrir. À Saint-Denis, en premier lieu, dont Jean-Claude Fall a régénéré l'esprit, à l'exemple de ce qu'il avait si bien fait au théâtre de la Bastille ; c'est là, entre autres, que nous avons été frappés par les dons du dernier-né des metteurs en scène qui compteront, Stanislas Nordey. Et, naturellement à Bobigny, à Vitry, où Alain Ollivier poursuit, modeste, strict, entêté, un travail exemplaire.
En décentralisation, quelques entreprises ont réalisé des séries de production intense. Les plus remarquables ont été le TNP de Villeurbanne, avec outre la tournée des pièces de Planchon, les créations de Pandora et de Zucco ; le Sorano de Toulouse où Jacques Rosner a mis sur pied un programme thématique de haute qualité ; le théâtre national de Marseille qui affirme une activité de création toujours aussi abondante et un rapport au public toujours aussi exceptionnel, avec tout particulièrement la triomphale reprise de Maître Puntila et son valet Matti, tenue par un Marcel Maréchal-acteur au plus haut de son talent.
Le secteur privé poursuit son bonhomme de chemin (pas plus, pas moins d'échecs et de réussites), grâce à l'aide solide de son Fonds de soutien. Les directeurs, c'est un fait, se laissent de plus en plus impressionner par le vedettariat des acteurs, au détriment des auteurs — dont ils étaient traditionnellement les découvreurs et les supporters. Comment leur en faire grief, face à l'augmentation constante de leurs charges et à l'engorgement médiatique dont souffre leur exploitation ?
Provisoirement, il faut se résigner : ce sont les acteurs vedettes qui sont à l'origine des projets et choisissent des pièces (s'il y a un « beau rôle » : ce piège !)... qu'ils ne veulent pas jouer longtemps, rêvant tout de même encore au cinéma. Alors même... que les gros succès du théâtre privé cette saison étaient joués par des acteurs connus et estimés (Mikaël et Desarthe, Freiss et Agenin, ou l'équipe de Cuisine et dépendances) mais non « vedettes ».. et que ces dernières échouaient à sauver par leur seul nom des spectacles artistiquement insuffisants. Ce qui est réconfortant.
Ce qui fait la grandeur du théâtre, ce n'est pas le concours irrégulier et capricieux de stars venues du cinéma, c'est l'acteur noble et strict, voué au théâtre, passionné par son art au quotidien. C'est Maria Casarès et Michel Bouquet, Denise Gence et Laurent Terzieff, Suzanne Flon et Gérard Desarthe, Ludmila Mikaël et Georges Wilson, Christine Fersen et Marcel Maréchal, Andrée Tainsy et Hubert Gignoux, Christiane Cohendy et Didier Sandre, Philippe Demarle et Aurore Briant, Dominique Valadié et David Warrilow...
Quoi qu'en disent leurs responsables, les théâtres privés n'ont qu'une (saine) vérité : pour « marcher » un spectacle doit être satisfaisant dans tous ses éléments. Des acteurs célèbres sont peut-être nécessaires mais ils ne sont pas suffisants.
Par ailleurs, une reconversion du répertoire traditionnel du boulevard se confirme : les auteurs les plus consacrés, habitués aux triomphes, sont laissés pour compte ; un dérivé du spectacle d'amusement issu du café-théâtre prend peu à peu la place du boulevard traditionnel. Sic transit. La comédie bourgeoise s'abâtardit.
Mais c'est sans doute l'émergence d'une série de jeunes metteurs en scène qui aura marqué la saison. Depuis des années, on se plaint de l'absence de relève depuis la grande vague précédente (celle des Chéreau, Vincent, Jourdheuil, Engel, Lavaudant, Françon, Fall, Bourdet...). Presque tout à coup, un groupe s'est dessiné : Jouanneau, Hakim, Pitoiset, Schiaretti, Tanguy, Rambert, et puis Nordey, Vigner, Braunschweig, Didym... Et des auteurs sont apparus ou se sont confirmés avec un ton et un style personnels, dans l'esprit du temps, de Daniel Soulier à Didier Carette, de Valletti à Jean Bois.
Tous ont, à ce jour, un trait commun : ils ne veulent pas de l'institution dont leurs aînés ont fait un modèle, ils veulent travailler en marge, se donner davantage un droit à l'erreur, soit en solitaires, soit en recherchant un nouveau rapport au public. Voilà d'incontestables signes de santé.
Cette abondance et cette diversité, ce sens du pragmatisme et du singulier, ces jeux de compétition, balisent à court terme le paysage imaginaire français, loin de tout rassemblement scolastique et du dévouement collectif qui marquaient les décennies précédentes.
Nous vivons à l'âge de la reproduction mécanique, au stade de l'événement rapide, de la performance immédiate, de la multiplication indéfinie des images, de l'oubli qui s'en suit, de la non-réflexion et de la non-mémoire. C'est ainsi. D'où, nous voulons le croire, le besoin accru, plus ou moins révélé, d'un espace de hasard, de rêve, d'invention, de lucidité possibles, en un mot : le besoin du théâtre. Sans perdre de vue que le théâtre plus que jamais, n'est pas un, mais qu'il est multiple. Et que c'est bien ainsi.
Il existe plusieurs secteurs sinon plusieurs sortes de théâtre, selon qu'il est ou qu'il n'est pas, selon la définition qu'en a donnée Michel Deutsch, « un théâtre privé d'art, privé de monde par conséquent »... « Tout théâtre ne se vaut pas, il existe des frontières et des antagonismes entre les théâtres, il serait absurde de vouloir unifier ce qui ne peut pas l'être.»
Dans la confusion présente, le théâtre peut trouver des raisons de prospérer. Qu'il prenne garde seulement à ne pas perdre de vue le sens qu'il contient, ce pourquoi il est fait, à qui il s'adresse et la dimension collective qui le définit.
ÉDITORIAL : À PROPOS D'UNE ANNÉE DE THÉÂTRE - Signes et réalités
(L'Année du Théâtre - 1992-1993)Cette saison théâtrale s'est déroulée sous le signe de la stabilité ; rien n'a corrigé ou inversé une des tendances relevées précédemment (5). Le seul événement susceptible de provoquer des transformations (au moins institutionnelles) fut l'entrée en fonction d'un nouveau ministre de la Culture ; celui-ci a, traditionnellement, procédé à quelques nominations à la tête de grandes institutions après plus d'une valse hésitation, et, avec une rapidité appréciable, réglé le difficile dossier des travailleurs intermittents du spectacle. Une évaluation globale, tous secteurs confondus, révèle une prolifération endémique des spectacles (nous avons recensé cinq cent soixante et un spectacles nouveaux, contre cinq cent trois la saison précédente — voir en annexe — en ne retenant ni les festivals, ni les productions qui ont été jouées moins de vingt fois). L'affectation mal contrôlée des subventions en est la principale cause ; mais en dépit des désordres et des confusions qui en résultent, la vitalité que cette surproduction atteste est un signe particulièrement positif de la bonne santé du théâtre.
LE THÉÂTRE ET SES PUBLICS
La fréquentation, aussi, est en hausse. Ce qui est réjouissant. Certes, d'aucuns, prêts à céder à une tendance ségrégationniste, trouveraient commode d'ignorer le quantitatif. Ils sont prêts à distinguer entre le bon grain (rare) et l'ivraie (la multitude) parmi les spectateurs, entre les « citoyens » et les « consommateurs », censés attendre, quand ils viennent au théâtre, les uns une réflexion exigeante, les autres une distraction réjouissante. Or, il en va du théâtre comme du goût ou de l'odorat : on ne peut à tout moment éprouver des sensations nécessairement ambitieuses ou nécessairement pures... c'est à chacun de se déterminer. Toute forme d'expression théâtrale a droit à l'existence, n'en déplaise à la cohorte proliférante des Trissotin, et tout public a droit au respect.
On ne peut non plus décider souverainement de hiérarchies en matière de création et de public. L'histoire du théâtre prouve que les jugements de l'instant sont révisés sans cesse, qu'on brûle le plus souvent demain ce qui hier était porté aux nues, et que les images (ô relativité de la mise en scène !) s'effacent vite et complètement de la mémoire.
Le théâtre, il faut le réaffirmer sans cesse, est un art de l'instantané, de l'éphémère. Il n'est pas reproductible. On ne peut pas le conserver. Citizen Kane ou La Règle du jeu peuvent être des échecs retentissants à leur sortie, on reprendra le film dans sa forme intacte des années après et l'œuvre trouvera son public. Si un spectacle de théâtre n'est pas vu le soir où il est joué, à l'instant même de la représentation, on ne le reverra plus, il n'existera plus... si ce n'est le texte qui lui a donné naissance (Michel Vinaver le formule dans ce livre excellemment).
CONFUSION DES SECTEURS
Cette année encore, on a vu s'estomper les barrières et jusqu'à la distinction même entre le théâtre public et le théâtre privé. Cela s'inscrit dans la grande déflation des idées et de la pensée théorique. Cela comporte des éléments positifs et des éléments négatifs : autant il est utile d'en finir avec un type de séparation agressif, autant il ne faudrait pas que chaque secteur d'entreprise y perde sa raison d'être et son identité.
Il est de fait que le répertoire de l'un et de l'autre devient commun. La tendance est à l'uniformité. Ce qui sera, tôt ou tard, lourd de conséquences, car c'est bien du répertoire que vient le premier distinguo sur lequel se décide le subventionnement.
Économiquement aussi, les différences s'estompent.
Les spectateurs — qui viennent dans les salles subventionnées et dans les théâtres privés le plus souvent pour les mêmes motivations ou pour les mêmes attractions — sentent beaucoup moins qu'auparavant la différence entre les prix des places d'un théâtre à l'autre. Les théâtres privés aménagent maintenant des prix réduits (pour les collectivités, les jeunes, etc.) proches de ceux pratiqués dans les salles subventionnées. Un fauteuil d'orchestre peut valoir pour certains spectacles deux cent vingt francs dans un théâtre privé et deux cents francs à la Comédie-Française (pourtant subventionnée à hauteur de plus de cent vingt millions de francs).
De part et d'autre, la production est grevée par ce que coûte l'inflation vedettariale des acteurs ou des metteurs en scène (Jacques Lassalle a reconnu avoir renoncé au concours de Bob Wilson tant sa prétention financière était excessive), et par l'outrance somptuaire des décors et des costumes.
C'est ici que s'accentuent les positions particulières. Le théâtre subventionné demeure, plus que jamais, sous la suprématie de l'image, et le théâtre privé se soumet à celle de l'acteur.THÉÂTRES SUBVENTIONNÉS : SUPRÉMATIE DE L'IMAGE
Les théâtres subventionnés sont dominés par les metteurs en scène, pour beaucoup de (bonnes) raisons, ne serait-ce que par ce que mettre en scène et animer un lieu procèdent largement de la même fonction.
Il est absurde de tempêter contre la primauté de la mise en scène sur le texte, cela procède d'un ferme processus historique tout au long de ce siècle.
Le rapport des dramaturgies nouvelles avec les théâtres du secteur public est étrangement ingrat et compliqué, et ce, au moins, depuis Vilar et le TNP lui-même. Il est de fait que la plupart des meilleurs auteurs n'ont pas été révélés là, et qu'on assite à une floraison d'une quantité d'œuvres théâtrales nouvelles qui semblent des produits bâtards du répertoire dominant, ou servir de caution à des subventions. C'est que les auteurs y sont souvent encore traités en cousins de province ou en invités de la dernière heure, à qui l'on réserve volontiers des « lectures » ou des « ateliers » ou des « groupes de travail » ou des « cycles » courts de représentations dans la « petite salle » de l'établissement. La SACD, qui devrait avoir à cœur d'illustrer ou de révéler ses auteurs, se limite, à Avignon pendant le festival, à financer la - lecture " par de « grands acteurs » de textes littéraires anciens non écrits pour le théâtre.Sur ce terrain, tout va dépendre de la rigueur avec laquelle le nouveau ministère de la Culture imposera fermement un cahier des charges aux entreprises qu'il subventionne. Le nouveau ministre estime nécessaire d'encourager l'écriture contemporaine ; attendons-le aux actes.
En corollaire, la mise en scène s'ébat dans une surenchère à l'image scénique la plus ;
Pour ce qui est de la Comédie-Française, par exemple, la réduction progressive du nombre des créations (six seulement, cette saison) tient, en particulier, à la charge décorative, qui par: ailleurs bloque l'alternance, réduisant la moitié (au moins) de la troupe au chômage. la encore, le cahier des charges doit être précisé et tenu. C'est une affaire de tutelle et de discipline.
L'excès auquel les metteurs en scène se laissent aller souvent, a pour effet la lassitude des spectateurs découragés par trop de didactisme, d'esthétisme ou simplement trop de rigueur. On a vu, en dépit de l'enthousiasme de la critique, un public ne pas s'en laisser compter (le Théâtre de la Ville l'a durement éprouvé), comme s'il était de moins en moins influencé par laa critique. Le vrai succès se décide et se prolonge par le « bouche à oreille ».Un équilibre peut être trouvé, sans pour autant vouloir réviser à la baisse la fonction de la mise en scène. Car enfin, on pourrait réfléchir un instant aux leçons que nous ont données Grotowski et Brook, par exemple, sans remonter aux calendes (Copeau, Vilar, etc.). Et fêter comme il le mérite le jeune Stanislas Nordey, qui a fait cette année si bien et si neuf avec son Calderon (voir notre couverture, en distinguo).
THÉÂTRES PRIVÉS : LA SUPRÉMATIE DE L'ACTEUR
Dans les théâtres privés, les acteurs-vedettes sont décisionnaires, c'est un fait.
Ils sont de plus en plus chèrement payés ; il n'y a rien à redire à cela, sauf que la part qu'ils prélèvent grève la charge des productions. La marge du gain est si étroite que tout risque devient exagéré.
Que faire ? Les directeurs, traumatisés, vous le diront : sans « vedette » point de succès... (c'est ce qu'ils affirment et c'est ce qui ne cesse d'être démenti ! cf. les triomphes sans vedette qu'ont été Les Palmes de M. Schutz, Cuisine et dépendances, Mortadela, Voltaire Rousseau et, même, dans une certaine mesure, Célimène et le Cardinal ou Ce qui arrive et ce qu'on attend).Deux effets secondaires sont de la plus extrême gravité.
L'un concerne l'appauvrissement du répertoire de création contemporaine. Les directeurs de théâtre ne choisissent plus une pièce nouvelle pour la distribuer ensuite. Ils engagent d'abord l'acteur-tête d'affiche (susceptible d'assurer une promotion médiatique) et lui demandent ensuite ce qu'il veut jouer. Venant du cinéma, et souvent sans projets (c'est un secteur en crise) celui-ci voudra moins que jamais prendre de risque. Il choisira de préférence un succès éprouvé à l'étranger ou un classique (on opte pour Marivaux, on consent à Claudel, on « ose » reprendre un Pinter).
Plus grave encore, d'autre part, est l'exigence de ces acteurs-vedettes à limiter le nombre des représentations.
Dès que le succès a redonné énergie à leur carrière, ils quittent la pièce qu'ils jouent au bout de trois ou quatre mois. Je n'évoque pas ici l'acteur qui a prévenu à l'avance qu'il arrêtera à une date précise, telle Sophie Marceau qui pour la deuxième fois (après Eurydice) vient de faire s'interrompre un Pygmalion triomphal : ce sont les producteurs qui se sont engagés dans ce spectacle en toute connaissance de cause au départ, qui en prennent dès lors la responsabilité. J'évoquerai par contre, un autre grand succès de la saison... que je connais bien, qui s'est joué dans le quartier de l'Opéra, interrompu contre toute attente par décision des acteurs, partis tourner un film.
Une telle pratique s'exerce au détriment des acteurs qui ne retirent pas l'entier profit de leur prestation ; au détriment des producteurs, privés du profit de l'entreprise, qui se montrent peureux en ne remplaçant pas les acteurs en partance ; au détriment du public qui ne comprend pas l'interruption d'un spectacle aux salles pleines ; au détriment de la pièce et de son auteur qui ne peut suffisamment s'imposer ; au détriment de tous les autres artistes et techniciens du spectacle privés de travail ; au détriment du théâtre, tout court, car un succès qui se prolonge est preuve de santé.
Applaudissons donc doublement les acteurs qui ne mesurent pas leur talent selon de purs critères égoïstes, tel Michel Serrault, qui va reprendre Knock une deuxième saison, dépassant les trois cent cinquante représentations. Et félicitons les producteurs quand ils prévoient par avance une deuxième distribution, telle Jacqueline Cormier qui a réussi un beau doublé pour L'Aide-Mémoire.
Rendons surtout hommage aux grands artistes de théâtre qui ont conscience de la solidarité nécessaire qu'ils doivent à tous ceux qui les entourent et au théâtre tout court auquel ils se vouent. Ce sont eux qui honorent leur profession. C'est à eux que vont notre admiration et notre estime. Ils sont légion, à commencer par Maria Casarès et Suzanne Flon, Michel Bouquet et Laurent Terzieff, Denise Gence et Michelle Marquais, Jean-Claude Brialy et Francis Huster, Michel Aumont et Jacques Weber, Geneviève Page et Emmanuelle Riva, Évelyne Didy et François Chattot, Dominique Valadié et Redjep Mistrovitsa, et tant d'autres...Saluons avec eux les directeurs qui engagent ces acteurs-là dans leurs théâtres, et qui n'ont pas l'outrecuidance de décider qu'ils « suffisent » ou pas à, seuls, « faire une affiche ».
(5) Cf. la préface de Théâtres 1991-1992 premier volume de la collection, paru aux Éditions Hachette
PORTRAIT D'ACTEUR : MARCIAL DI FONZO BO
(L'Année du Théâtre - 1994-1995)Rarement un comédien connut débuts si éclatants. À peine sorti de l'école du Théâtre national de Bretagne, le voici dirigé par Claude Régy (Paroles du sage) et Matthias Langhoff (Richard III), jouant en solo avec le premier, assumant le rôle titre avec le second. D'abord attirant singulièrement l'attention, inspirant ensuite la plus vive admiration.
Michel Cournot (Le Monde) a évoqué longuement son interprétation dans le texte biblique : « Cheveux coupés très ras, grosses galoches, pantalons et blouse rugueux sombres comme de la ratine de prisonnier. Très beau regard enflammé, douloureux, innocent, têtu. Avec un infime accent qui accentue et « mélodise » certaines toniques, Marcial Di Fonzo Bo fait émerger du silence une des pages les plus célèbres de la Bible...
L'acteur dit le texte lentement, d'une voix de combattant blessé, par moment exténuée. L'auditoire est suspendu à cette « buée », à cette « haleine », suspendu aussi au très étrange jeu des deux mains qui, en une danse légère, évoluent lentement devant l'acteur, dans l'espace, comme deux oiseaux planeurs qui ne seraient pas tenus par les bras, qui librement réagiraient aux paroles du « Sage », qui s'étonnent, approuvent ou flottent, mais qui évoquent aussi la jeune fille d'une gravure de Dürer qui « attise le feu avec une aile d'oiseau. »
Le plus beau, c'est que ce jeu et que ce chant du très étonnant acteur Marcial Di Fonzo Bo, orienté de très près par Claude Régy, rappellent les recommandations de lecture que donne la grosse voix sévère de Paul Claudel : « Considérer la Bible comme une chose à manger. Prendre Dieu au mot, se livrer naïvement à sa parole pour la reparler en soi-même, pour la dévorer, pour la faire passer tout entière dans ses entrailles par l'intermédiaire des dents, de la langue, et du goût, il faut nous persuader qu'elle est tout entière du pain. »
Ce qui, en intensité, s'inscrivait dans une interprétation poussée jusqu'à l'épure, dans un registre d'économie et de lenteur extrêmes, s'est changé, en Avignon, en une projection de jeu d'une mobilité, d'un lyrisme presque agressifs. Évoluant avec une aisance confondante, des rigueurs shakespeariennes aux permissions offertes par la mise en scène, Marcial Di Fonzo Bo, impérieux, nijinskien, inspiré, s'est soudain placé au premier rang des acteurs de sa génération...
« Le rôle en or de Richard (écrit encore Michel Cournot) est joué par Marcial Di Fonzo Bo, toutes les névralgies passagères d'enfance, de férocité, de gratuité de jeu, de perversion, passent comme ces si rapides nuées d'orage qu'aucun dieu ne sait arrêter. »
ÉDITORIAL : LA FORÊT DE VARIANTES MULTIPLES
(Théâtres - mars 2002)« La gifle. Ce dont on a rêvé, en réalité, n'a jamais existé. Reste le cadavre de pierre blonde ». (Jean Vilar)
Bertolt Brecht donnait du théâtre épique une définition posée : « Le théâtre épique ne combat pas les émotions, mais, au lieu de se borner à les susciter, il les soumet à examen ». De prime abord, cette attitude « critique » pourrait servir d'outil pour mieux cerner ce qui sépare le théâtre public et le théâtre privé - distinction que la plupart, artistes et public, rejettent, si l'on en croit l'approbation qu'a provoquée notre premier éditorial et la prise en compte de genres de théâtre différents.
Pour citer Brecht à nouveau - nous saluons avec plaisir dans ce numéro la permanence de son œuvre - à Walter Benjamin qui lui disait, à propos de Kafka : « Kafka est le premier écrivain communiste » ; Brecht répliqua « Et moi je suis le dernier écrivain catholique ! » (il y avait du vrai, d'une part comme de l'autre !). Brecht refusait, contre tout présupposé dogmatique, les étiquettes et les divisions catégoriques.
C'est à partir de « la forêt de variantes multiples», comme il écrit ailleurs, que s'ordonnent les axes d'une démarche artistique.
Le théâtre privé ne serait-il fait que d'émotions intéressées et étrangères à l'examen, et le théâtre public le promoteur désintéressé d'émotions strictement analysées ? L'hypothèse, en théorie, est plaisante.
Mais, à l'épreuve de la pratique, et un demi-siècle au moins après que Brecht ait écrit cela, que penser des ambitions des uns et des autres? À l'heure même où disparaît Jacques Mauclair qui, héroïque, a passé sa vie hors subventions, peut-on dire que le profit recherché par un théâtre privé est seulement et cyniquement monétaire ? Inversement, ce qui détermine strictement les choix d'une entreprise subventionnée est-il rigoureusement toujours conforme au service public ? Il y a de quoi gloser. Pour ne parler que des choix artistiques, des pièces de Genet, Copi, Novarina ou Patte ont pu être créées dans un théâtre privé, autant que dans un subventionné - j'en ai été l'artisan dans les deux cas, dans les théâtres que j'ai dirigés, pardon de me citer - mais, pour avoir été, dans un cas, personnellement responsable sur mes biens, je sais quel tribut à l'angoisse, à l'insomnie, aux privations de toutes sortes on est exposé... tout autant que, dans l'autre cas, j'ai su combien il est aisé d'exercer son mandat, en étant protégé des risques que l'on prend.
Trop souvent, la recherche de la sécurité et du confort sont de règle. Où sont les efforts et la peine ? On attend des artistes d'aujourd'hui qu'ils appréhendent l'histoire et s'ouvrent au monde et à ses fureurs. Il y faut du talent. Eisenstein, cité dans Le Monde par Michel Cournot, « avait dit que l'histoire, approchée comme il ne faut pas, se défend, et le maladroit se retrouve avec l'œil au beurre noir. »
Combien sont-ils ceux qui boxent et risquent de se retrouver l'œil au beurre noir ? Il est de bon ton, cette année, de multiplier les entreprises tièdes ou tronquées. On joue à s'imiter, en multipliant (six à huit cette saison) les École des femmes, les Mouette, les Roméo et Juliette, sans parler du constant refuge thékhovien ; ou, dans le privé, à monter le peu qu'il reste de comédies anémiques rappelant le vieux Boulevard.
Il faut dire que le terrain de la dramaturgie n'était pas le même lorsque s'est marquée la division public-privé, dans les années cinquante. avec l'avènement de Jean Vilar, qui eut à batailler contre les stars de la grande comédie bourgeoise, tandis que les pionniers de la Décentralisation s'opposaient en région aux tournées parisiennes. Vilar avait l'heureuse opportunité de pouvoir créer des œuvres d'auteurs classiques (certains Marivaux) ou des auteurs inconnus appelés Brecht, Kleist, Büchner. Ce n'est plus le cas ; il n'y a plus rien (ou presque) à découvrir.
Aujourd'hui, par ailleurs, les directeurs subventionnés montrent un étrange manque de curiosité pour l'écriture contemporaine. Organiser quelques maigres représentations de pièces nouvelles, multiplier les mises en espaces, les répétitions publiques, les lectures surtout - cette plaie pour les auteurs, cette pauvre poire pour la soif, cette mauvaise excuse - ne sont que des pis aller, qui, tout compte fait, desservent les auteurs.
Comment refuser les catégories et entrer librement dans « la forêt de variantes multiples autrement dit revendiquer un espace libre de création ? Comment la création peut-elle prévaloir sur le poids de l'institution ? Tout artiste ne s'affirme qu'à partir de l'inconnu...
René Char se demande « comment vivre sans inconnu devant soi ? »
Char, encore, affirme : « Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te voir ils s'habitueront »...
Ou encore, ainsi que l'a reclamé Jean Genet, » mieux vaut enflammer qu'enseigner » (je cite de mémoire).À quand la « création citoyenne » ? ... En période électorale, on peut rêver !
ÉDITORIAL : DU CHANGEMENT
(Théâtres - mars 2002)En ce printemps, trois sortes d'événements ont traversé une actualité faible: de nouvelles propositions scéniques réduites au plus sommaire; la mise en œuvre d'une décentralisation revitalisée; l'affirmation éclatante d'un art de la mise en scène venu de l'étranger. Le tout, sur fond d'attentisme apeuré, de déshérence politique et de catastrophes internationales. Une étrange saison théâtrale prend ainsi fin, prématurément (au mois d'avril), laissant dans un réel découragement bien des initiatives et des bonnes volontés, et plusieurs théâtres vides.
Tout change. « Le changement seul est éternel » a écrit Paul Claudel. Nous assistons à une mutation. Il est évident que nous allons perdre, ou que nous avons déjà perdu, une pratique du théâtre venue de l'après-guerre, que nous aimons, ou avons aimé, exercer. Il faut accepter le changement, que cela plaise ou non... Déjà, une forme de suprématie du metteur en scène est en perte de vitesse, d'où une revalorisation du texte, ce qui permet à l'acteur de tirer son épingle du jeu. Plus largement, c'est l'économie même des théâtres et le rapport au public qui sont remis en question. Certains projets politiques n'arrangent rien, qui mettent en avant une civilisation du loisir, qui dévalorisent la fonction culturelle et celle du travail. Le théâtre s'accomode mal des trente-cinq heures, qui produisent un effet catastrophe sur la gestion (la Comédie-Française vit, plus que jamais, dans un fantasme de grèves à répétition). Cette évolution est étroitement liée à l'inculture de la plus jeune génération active, celle des vingt/vingt-cinq ans : est-ce dû à la télévision, au temps du restau-rave, à la confusion des genres, à la carence des éducateurs, à l'effondrement des modèles transmis par leurs aînés, tout cela ensemble sans doute ?
Le théâtre, reflet à chaud d'une société, qui a besoin de recul pour faire face aux événements, reste frileux, perplexe. Un découragement se fait sentir, momentané. Dialectiquement, cela produira du neuf, mais on ne l'aperçoit pas encore clairement. Plus que jamais Edgar Morin peut affirmer que « nous vivons dans un monde qui n'en finit pas de finir, et dans un monde qui n'en finit pas de commencer ». Ou encore, de nous référer à Antonio Gramsci, à qui l'on demandait: « Qu'est-ce qu'une crise? », et qui répondait: « C'est lorsque le vieux meurt et que le neuf hésite à naître».
« Comment va le monde, môssieu, il tourne môssieu », énonçait aussi le cher François Billetdoux. Qu'avons-nous à l'affiche? La tendance est à la multiplication des acteurs en solo. L'acteur s'exhibe à bon compte (pas d'enjeux de groupe, pas de tension avec un metteur en scène, pas de rivalité) et le directeur du théâtre se régale de même (pas de frais de montage, pas de complication, un personnel réduit au minimum, plusieurs programmations à des horaires différents et plusieurs recettes). Cela produit aussi un réel déficit pour les autres métiers de la scène (auteurs, metteurs en scène, décorateurs, costumiers, techniciens) et habitue le public à une intimité paresseuse avec les artistes. Fabrice Luchini est le seul (avec, d'une autre manière, Sami Frey et Jacques Weber) à avoir fait de ces exhibitions un art. Sa nouvelle prestation - sur des textes de Louis Jouvet (sur le théâtre) - souligne le paradoxe. Si un artiste n'a cessé de prôner la nécessité de la troupe et du texte dramatique, l'obligation du travail collectif et de l'œuvre écrite, c'est bien Jouvet. On n'imagine pas, à l'Athénée, jadis, Jouvet en solo disant des textes de Copeau ou d'André Antoine ! Signe des temps, comme si le théâtre devait être réduit à une complicité duelle et confidentielle que favorise la télévision.
À l'opposé, un sang neuf bat du côté de la Décentralisation. Une nouvelle énergie anime des équipes loyalement engagées dans l'application de leur cahier des charges et dans une action locale, tels Philippe Delaigue et Christophe Perton du côté de Valence, ou Claire Lasne dans la région Centre. Elle provient aussi de l'initiative d'une action en Haute-Corse ou d'un groupe de marcheurs enthousiastes, décor et accessoires sur le dos, et le nom de Mesguich résonne heureusement parmi eux. Il est encourageant que des forces neuves surgissent dans un paysage institutionnel marqué par le manque d'imagination d'animateurs/metteurs en scène qui rivalisent platement en montant simultanément on ne sait plus combien d'École des Femmes, de Mouette ou de Platonov.
Le travail des metteurs en scène venus de l'Est est venu démontrer comme une gifle les carences de nos metteurs en scène. Hormis Nordey, qui, indépendamment de ses excès institutionnels, demeure le plus doué de sa génération, et un Dan Jemmett jubilatoire, qui peut prétendre à une œuvre aussi créatrice et provoquante que celle d'un Marthaler ou d'un Castorf, exemplaires dans leur travail sur l'espace et entraînant des acteurs aux talents multiples. Dans leur cas, en effet, la mise en scène cesse d'être un éventuel abus de pouvoir, pour s'affirmer un art, autonome, magistral.
« II faut savoir transformer l'événement en décision », écrit Brecht. L'événement, c'est la déshérence d'une organisation que l'on voit s'épuiser. La décision, serait d'oser traverser le système institutionnel dominant et de resserrer les rangs autour de ce qui fait le théâtre le plus irréductible, autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Il est permis de le penser et d'y croire, non sans « un rire », comme le titre le cher Hubert Gignoux dans son Histoire subjective de la Comédie (6). Un rire, à la fois sceptique et crédule, qui prépare à reagir et à agir. Un rire, pour demain, une fois finie cette saison, qui fut, c'est certain, de transition.
(6) Un rire, essai d'histoire subjective de la Comédie de Hubert Gignoux, Éditions L'harmattan, 2002
HOMMAGE : RAYMOND GÉRÔME
(Théâtres n°2 avril 2002)L'homme était hautain et tendre, et d'une élégance naturelle péremptoire. Un homme et un artiste de caractère aussi (en désaccord, il ne transigeait pas; en conflit, il ne renonçait pas - ses démêlés avec Madeleine Robinson lors de la création de Qui a peur de Virginia Woolf sont restés célèbres). L'artiste était d'une vive intelligence, cultivé, fin lettré, écrivain à ses heures (quelques pièces de théâtre; des adaptations qui ont fait autorité - à propos d'Oscar Wilde, notamment; plusieurs romans aussi.) C'était un comédien rare, qui pouvait (qui avait) tout joué, dans tous les genres, précieux et tendre dans le drame, pittoresque ou même burlesque dans la comédie. Il s'était fait metteur en scène très tôt et avait monté une centaine de pièces, dans les théâtres privés comme à la Comédie-Française.
Belge d'origine, il avait fait ses études à l'Université de Bruxelles et à l'école d'art dramatique Charles-Dullin, avant de fonder dès 1940 les jeunesses Théâtrales de Belgique et de monter des dizaines de spectacles au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles puis au Théâtre National, dont il sera le directeur artistique. Après une saison à Londres (il était bilingue), il s'installe à Paris en 1952, après avoir obtenu un grand succès dans Cocktail Party, qu'il jouait et mettait en scène avec le Théâtre national de Belgique. Très vite, on le retrouve à l'affiche des meilleurs spectacles comme acteur et/ou metteur en scène. Il dirige Marie Bell dans Phèdre et Daniel Ivernel dans Britannicus, Paul Meurisse et Pierre Brasseur, dans Don Juan aux enfers de Shaw, Madeleine Robinson dans Qui a peur de Virginia Woolf d'Edward Albee, Danielle Darrieux dans Les Amants terribles (Private Lives) de Noël Coward, Yvonne Gaudeau dans La Parisienne a la Comédie-Française, Jean Marais et Edwige Feuillère dans La Maison du lac. Il avait révélé Sam Shepard dont il avait mis en scène L'Enfant enfoui, joué L'extravagant M. Wilde, créé Trahisons de Harold Pinter, où il avait remarquablement dirigé Caroline Cellier, Sami Frey et André Dussollier. Il avait (difficilement) réalisé son ultime mise en scène à la Comédie Française, avec La Guerre de Troie n'aura pas lieu.
En 1980, il avait introduit un genre, dont on abuse aujourd'hui, celui des acteurs seuls en scène incarnant un texte non théâtral, en créant un remarquable Évangile selon Saint Marc. Raymond Gérôme avait fréquemment joué ou mis en scène pour le compte de son ami Lars Schmidt, producteur et alors directeur du Théâtre Montparnasse. Leur entente et leur complicité furent exemplaires.
HOMMAGE : JACQUES MAUCLAIR
(Théâtres n°2 avril 2002)Comédien depuis 1946, il avait été élève de Louis Jouvet, avec qui il débuta à l'Athénée dans La Folle de Chaillot. Il demeura dans la compagnie jusqu'à la mort de Jouvet (jouant auprès du maître L'École des femmes, Tartuffe et Don Juan, Knock).
Il était rompu à l'esprit du Cartel et à celui d'un répertoire vivant, acteur de troupe, peu à peu devenu un (admirable) grand premier rôle.
Il joua et/ou dirigea plus de cent pièces, ouvert à tout, curieux de tous, jamais embarrassé par les genres. Il écrivit des vaudevilles, Zozo; ou il en mit en scène au Boulevard, c'est lui qui dirigea Oscar à la création, avec Belmondo et Mondy, Elvire Popesco dans La Voyante, Sophie Desmarets dans Adieu Prudence ou N'écoutez pas Mesdames de Guitry). Passionné de théâtre russe (il montera souvent Tchekhov et adaptera L'Idiot, L'Éternel Mari) et de ce qu'on appelait le théâtre de l'Absurde, il servit Adamov (Le Professeur Taranne) Georges Schéhadé (L'Émigré de Brisbane à la Comédie-Française) et surtout son cher Eugène Ionesco, au nom duquel il demeure lié.Ionesco fut sa passion et sa grande affaire. Tant comme acteur, car il fut sublime dans le Vieux des Chaises ou dans Le Roi se meurt, que comme metteur en scène. Nous n'oublierons pas Victimes du devoir, Macbett, Ce formidable bordel, L'Homme aux valises. Ionesco lui doit beaucoup.
Il avait aussi diversement participé à Célimare le bien aimé, La Maison de Bernarda, La Tempête, Carlotta, Service de nuit, Brève rencontre, Le Loctaire d'Orton, Les Adieux de la grande duchesse, La Créole opiniâtre, Le Séquoïa, Henry IV de Pirandello, Androclès et le lion de Shaw, Comédie sans titre de Svevo, Le Grand invité, En famille, on s'arrange toujours, etc.Une existence au service du théâtre. Admirable.
Il fut un héroïque directeur de théâtre: du Théâtre de l'Alliance-Française, rebaptisé Théâtre Rive-Gauche (rien à voir avec le théâtre qui porte ce nom aujourd'hui) de 1971 à 1975, au Théâtre du Marais, qu'il a fondé (de 1976 à 2000). Chaque fois, il fut chassé par les créanciers.
Inlassable, renaissant après ses faillites, brave, fier, son travail, son œuvre, et son talent sont exemplaires.
Il devrait être pris en exemple par tous les animateurs-directeurs de théâtre (à commancer par les subventionnés) et par tous les comédiens (surtout les jeunes, qui louchent vers les sitcom). Nous ne vous oublierons pas. Chapeau bas, et un immense merci, cher monsieur Mauclair.
LARS SCHMIDT : LETTRE À UN AMI...
Dans un pays comme le nôtre où l'on n'aime ni la réussite ni le succès, est-il raisonnable d'avoir estime ou tendresse pour un homme et un artiste tels que lui, que ce soit pour les vingt années où il dirigea le Théâtre Montparnasse, ou pour ses productions ?
Est-ce admirable d'avoir créé les pièces des meilleurs auteurs avec les meilleurs acteurs ? Tennessee Williams (Le Tramway nommé.., La Chatte sur le toit..., La Descente d'Orphée) ; O'Neill (Long voyage dans la nuit) ; Le Journal d'Anne Frank, Douze hommes en colère, Deux sur la balançoire, Qui a peur de Virginia Woolf, Le Prix ? Révélant Peter Schaffer (Black Comedy), Murray Schisgal (Love), Arnold Wesker (Les Quatre saisons) ? Ou confirmant l'accès d'Harold Pinter au théâtre privé (C'était hier, Trahisons)... On le voit, le théâtre anglo-saxon doit à Lars Schmidt ses événements les plus flagrants, y entramant des acteurs appelés Arletty, Jeanne Moreau, Gaby Morlay, Annie Girardot, Madeleine Robinson, Delphine Seyrig, Nicole Courcel, Marlène Jobert, Pierre Fresnay, l'ami Raymond Gérôme, Laurent Terzieff, Claude Rich, Jean Rochefort !
Pis : ce révélateur ne témoigne pas moins d'énergie en faveur du théâtre de langue française. Après un (retentissant) Britannicus avec Madame Jamois et Ivernel, ne s'est-il pas permis de créer La Hobereaute d'Audiberti avec Spira et Le Poulain, L'Architecte et l'empereur d'Assyrie et Sur le fil d'Arrabal, Jeux de massacre de Ionesco, Exercices de style de Queneau... Sérieusement, de tels actes sont-ils pardonnables ?
Et n'a-t-il pas eu l'audace de nous offrir Ingrid Bergman, sublime, illuminant Hedda Gabler ?
Que signifie cette cinquantaine de productions qui toutes (ou presque) ont été des succès et plus d'un quart des triomphes?
Et, pour charger son cas, voici Lars Schmidt metteur en scène. Le voici conduisant, la tirant doucement par la main, toute grâce de cygne et charisme intacts, Anouk Aimée, notre Lola, qui depuis un ancien Sud reculait, effrayée, à la vue d'un plateau de théâtre. Et qu'il lui fait faire couple avec un autre comédien magique et tout aussi parcimonieux, Bruno Cremer. À qui, mieux qu'à ces deux comédiens confier des Lettres d'amour ? Quel couple est-il mieux assorti ?
Vous l'avez deviné, les dénégations qui précèdent ne sont qu'aveux pudiques, signes de reconnaissance. Je considère Lars Schmidt comme l'homme le plus probe, avec quelle élégance, et l'un des tous premiers artistes du théâtre français - car ce Suédois est plus Français que nature.
Je sais que, comme d'autres et parmi les meilleurs, il ressent péniblement le désordre et le durcissement qui sont dominants au théâtre en ce moment. Nous disons à Lars Schmidt: qu'il tienne bon, qu'il ne se laisse pas tenter par des cieux plus cléments. Qu'il bataille.
PIERRE LAVILLE : SAM SHEPARD ETAIT UN FAUX COW-BOY A L'ELEGANCE NONCHALANTE
Pierre Laville, traducteur de Sam Sheppard et auteur, metteur en scène - Publié le 01/08/17 mis à jour le 08/12/20Auteur et metteur en scène, Pierre Laville a traduit “Curse of the starving class”, l'un des chefs-d'œuvre de Sam Shepard. Il rappelle la place essentielle du dramaturge et acteur, disparu le 27 juillet 2017, dans le théâtre américain contemporain. Sam Shepard est sans doute connu davantage par le cinéma. De fait, il est au théâtre comparable à Clint Eastwood, autant pour l’esprit (voir, par exemple l’admirable Josey Wales, hors la loi ) que pour une allure de cow-boy dégingandé, endurant et mélancolique d’Hollywood à sa grande époque.
Mais il fut surtout un dramaturge phare du théâtre américain contemporain, recevant le Tony Award pour la meilleure pièce, et le prix Pulitzer en 1979 pour Buried child. Il a écrit plus de quarante pièces, dont Curse of the starving class (Californie, paradis des morts de faim), Buried child, True West (L'Ouest, le vrai), Fool for love, dans les années 70, 80. Il écrivit pour le théâtre toute sa vie, comme Tennessee Williams (qui glorifia le Sud et dont il serait le héraut symétrique pour le désert et le Nord américain), même si ses dernières pièces ne sont pas à la hauteur de ses premiers chefs-d’œuvre.Dans plusieurs de ces pièces, le gémissement du coyote ponctue par une note d’angoisse la solitude et l’égarement de cavaliers de l’Illinois et du Montana. Un théâtre de la solitude, de la perte, du deuil impossible du rêve américain est dressé. Angoisse très contemporaine du chômage, songes illusoires d’une terre devenue inculte à force d’exploitation, effacement des repères de l’enfance, les thèmes du théâtre de Sam Shepard sont noirs, cruels, sans issue. On y vit mal, on y meurt encore plus mal. Alcool et misère, chair déchue, espérances en berne, les frères se dressent les uns contre les autres, les femmes sont des icônes sexuelles dérisoires, le temps défigure et décourage.
“Shepard se définissait comme un homme de théâtre complet”
Cette noirceur fait penser aux grands dramaturges nord européens. Non sans humour, ni conscience, invoquant les déchus ou les morts de faim et de solitude laissés-pour-compte, les pères violents et abusifs (il eut à souffrir du sien), les mères défaites, les prostituées à la dérive. Ils vivent comme ils meurent, seuls, dans des espaces trop vastes, secs, épuisés. Cavaliers romantiques, d’une misère très contemporaine, qui survivent de nos jours aux Etats-Unis.
Dans le théâtre américain postérieur à Tennessee Williams, il est passionnant de comparer, sinon d’opposer Sam Shepard et David Mamet, les deux grands maîtres du théâtre américain aujourd’hui. Au cours des années 80 à Chicago, deux théâtres rivaux, le Goodman Theatre et le Steppenwolf Theatre, avaient leurs auteurs phares : David Mamet pour l'un, Sam Shepard pour l'autre. Mamet dont je venais de faire la connaissance et qui traduisait ma pièce (Red river) se réclamait de Tchekhov, accompagné par Al Pacino, et Shepard, sorte d'Ibsen, entraîné par Malkovich. Ami de Mamet, j’ai tout de même traduit un des chefs-d'œuvre de Shepard, Curse of the starving class (qui fut joué à la Criée de Marcel Maréchal par notamment l'admirable comédienne Nelly Borgeaud). Sam Shepard était un faux cow-boy à l'élégance nonchalante et poétique d'un Henry Fonda (Mamet, un boxeur à la James Cagney)... Il se définissait comme un homme de théâtre complet – auteur, acteur, metteur en scène, producteur), ce qu'il fut un demi-siècle durant.
EDWARD ALBEE, LA NOSTALGIE DE L'ENFANT
Pierre Laville - Publié le 17/09/16Le dramaturge américain, auteur, entre autres, de “Qui a peur de Virginia Woolf ?”, est mort ce vendredi à 88 ans. Pierre Laville, traducteur d'Albee en France et lui-même auteur et metteur en scène (“Le Fleuve rouge”, “Etoiles”...), se souvient pour “Télérama”.
Le théâtre américain est âgé d’à peine un siècle. Il est dominé principalement, une génération après l’autre, par successivement Eugène O’Neill (le père fondateur), Tennessee Williams, Arthur Miller, Edward Albee, David Mamet et Tony Kushner. Tous s’inscrivent dans une sorte de longue phrase de commentaire critique sur l’Amérique en crise d’identité, dans un règlement prolongé de ce que l’on a appelé le Rêve américain.
Avec la mort d’Edward Albee, le théâtre perd l’un de ses auteurs majeurs. Il disparaît, âgé de 88 ans, après un Alzeimer, qui lui laissa le temps de recevoir en 2005 un vaste « tribute » pour l’ensemble de son œuvre que lui ont rendu l’ensemble des artistes américains.
Mis à la porte par sa mère
Il a vécu une vie âpre, doublement sous le signe de son homosexualité (enfant né de parents inconnus, adopté par un couple, Reed et Frances Albee, propriétaires de salles de spectacle, il fut mis à la porte par sa mère, quand il avait dix-huit ans en raison de son homosexualité) et par le monde du théâtre, qu’il découvre enfant, puis adolescent dans le Greenwich Village des années cinquante, fréquentant intellectuels, écrivains et musiciens. Double dominance, et source d’inspiration et de souffrance, d’austérité, d’exigence et de rigueur.
Edward Albee était un petit homme fluet, au visage aigu, presque un museau de renard. Il attirait d’emblée par un regard perçant clair, subitement chargé de tendresse et d’humour et redevenant tout aussitôt sombre, se passionnant sans concession dès qu’il était question de sexualité et de théâtre.
Albee ou l'exigence
Si je devais le définir, je retiendrais de lui cette exigence qu’il radicalisait. La première fois que je l’ai rencontré, il se préparait tout bonnement à prendre l’avion pour aller interdire les représentations de Qui a peur de Virginia Woolf ? au Théâtre national de Stockholm, pour avoir enfreint ses didascalies décrivant le décor de sa pièce, car il l’exigeait conforme au plus petit détail près – je n’ai connu semblable rigueur que chez Genet ou Vauthier.
Un de mes grands bonheurs fut l’échange que nous avons eu concernant la traduction de ses pièces (*) et je conserve de notre travail commun et de nos commentaires le souvenir de marques d’une époque (bien révolue !) où un auteur voulait et pouvait faire respecter voluptueusement le moindre signe de son texte comme, disait-il, le moindre espace d’un tableau – est-ce qu’on ose corriger l’œuvre d’un peintre ?
Un théâtre sur la maladie du temps
Il a écrit une trentaine de pièces. Comme Tennessee Williams, plusieurs chefs d’œuvres de renommée internationale alternent avec autant d’échecs retentissants. D’Edward Albee, lauréat de trois prix Pulitzer et deux Tony Awards, les grandes pièces les plus connues – Qui a peur de Virginia Woolf ?, Zoo Story, Délicate balance ou Trois Femmes grandes – suivent un fil cohérent, celui de l’angoisse du temps et des origines, prolongée par la nostalgie et la perte de l’amour.
Il ne s’agit pas, sinon en apparence, d'un théâtre naturaliste ou de réalisme psychologique, mais, selon la belle proposition de Jean-Louis Barrault, qui le mit en scène à l’Odéon, d’un théâtre objectif sur « la maladie du temps ». Un théâtre, qui projette une trajectoire humaine, menacée par le déséquilibre de l’échec et de la folie, éperdûment en quête d’un ventre maternel et du désir de l’enfance. Barrault parlait de Tchekhov à son sujet, et il n’avait pas tort – Alain Françon qui le mit en scène récemment a dû y penser.
Des œuvres, dont se sont régalés nos grands comédiens, de Laurent Terzieff à Xavier Gallais, de Madeleine Robinson à Béatrice Agenin et à Dominique Valadié, de Madeleine Renaud à Geneviève Page, de Raymond-Gérôme à Claude Dauphin et à André Dussollier, d’Edwige Feuillère à Denise Gence… Théâtre d’acteurs, de pure structure classique, davantage que de metteurs en scène.
Le drame de l'enfant
C’est enfin une œuvre aux dimensions multiples – à commencer par la vraie portée de sens de Qui a peur de Virginia Woolf ?, dont les héros, prénommés Georges et Martha (Washington), ne se consolent pas de leur incapacité à mettre au monde un enfant, qui préparerait un futur différent à une Amérique privée de son rêve et devenue stérile. Grande métaphore, que l’on retrouve dans The Play about a Baby, pièce encore inédite en France, poussée à l’extrême, apurée, de manière quasi-beckettienne.
Dramaturgie de l’échec américain, réduit à un étouffement bourgeois comme dans Délicate balance… ou, dans Trois Femmes grandes, à l’horreur d’une reconnaisance maternelle impossible, qui conduit à la déchéance et à la mort. Albee y demeure un éternel enfant seul, au désespoir grinçant.
Une oeuvre au noir
Le théâtre d’Albee est tout d’une matière brillante et noire, sèche et généreuse, sans indulgence et sans pardon, parfois sec, ce qui le rend singulier et puissant.
On ressentit cela dès sa première pièce présentée à Paris en 1959, La Mort de Bessie Smith (par Jean-Marie Serreau, celui qui a tout découvert), axée sur la grande Bessie S. abandonnée mourante à la porte de l’hôpital à cause de sa couleur, de son identité, de sa poésie, de sa vie d’artiste, de sa différence, toute une projection qui allait sous-tendre la vie et l’œuvre du dramaturge américain.
(5) (*) D’Edward Albee, Pierre Laville a traduit Zoo Story, Qui a peur de Virginia Woolf ?, Délicate balance, Trois Femmes Grandes, The Play about a Baby, Occupant, Peter and Jerry.